A l’occasion de la 10ème Edition des Rencontres Images Mentales, les organisateurs ont souhaité « aller interroger le passé », comme l’explique Martine Lombaers (coordinatrice) en introduction, et amener le public à porter un regard politique sur les films historiques « pour appréhender l’avenir au regard d’un présent ultra-médiatique ». Ainsi, Images Mentales démarre cette année avec deux journées de rétrospectives. Nous avons réuni trois plumes pour partager avec vous les documentaires visionnés au cours de ces journées.
Une rétrospective faite de (r)évolutions
Manon Gobeaux et Juliette Vanderveken« Saint-Alban – une révolution psychiatrique », de S. Cantalapiedra (60’, France, 2016), ouvre la première journée de projections des Rencontres. Il n’en fallait pas moins pour démarrer cette nouvelle édition et donner le ton. « On pourrait qualifier le film sur Saint-Alban de « passéiste », et pourtant… il soulève nombre de questions à réactualiser ! » (Pierre Smet, psychanalyste intervenant lors du débat).Saint-Alban, c’est un petit village perdu en Lozère où se trouve un hôpital psychiatrique, ou plutôt un asile carcéral aux méthodes archaïques au moment de l’arrivée du jeune docteur Paul Balvet. Saint-Alban, c’est surtout le théâtre d’une rencontre, celle de quatre jeunes médecins (Paul Balvet, François Tosquelles, Lucien Bonnafé et André Chaurand). Ensemble, ils vont révolutionner la prise en charge des patients de l’hôpital et bien au-delà, le monde de la psychiatrie.Toute leur histoire à Saint-Alban montre un processus d’humanisation de l’hôpital et, par-dessus tout, une volonté de rompre avec les coutumes de l’asile, d’ouvrir les portes et de briser les murs. Ce qui compte avant toute chose pour ces soignants, c’est la relation au patient et la (re)mise en activité de ce dernier. Ils appliquent des méthodes nouvelles dans la prise en charge des personnes malades, dans le rôle et l’implication de l’équipe soignante, ils s’essayent à une gestion horizontale et non plus verticale… et, par tous les moyens, ils tentent de « briser les murs » de l’asile. L’idée défendue par H. Simon « il faut soigner l’hôpital avant de soigner les gens » est reprise, c’est la naissance de la psychiatrie institutionnelle.
« Le lien entre la résistance et ce qui fait soin, c’est cela qu’il est nécessaire de garder vivant à l’intérieur de nous » (Mounia Ahammad, infirmière intervenante lors du débat)
Dans ce témoignage, il est question ici aussi de s’essayer à un mode de gestion et de prise en charge différent, sans hiérarchie au sein de l’équipe et où chacun, quelle que soit sa fonction, est responsable de la prise en charge de patients, les tâches de nursing sont partagées, etc.Ces expériences, tout comme les avancées spectaculaires pour l’époque à Saint-Alban, ont malheureusement pris fin à un certain moment et pour diverses raisons. Dans les deux cas, on cite l’arrivée de la psychiatrie managériale et des indicateurs quantifiables, la gestion des lieux par des « managers » et non plus par l’équipe soignante, et la place de plus en plus importante laissée à la pharmacologie. Pourtant, « on n’a pas vu un malade agité en 50 ans à Saint-Alban ! » martèle François Tosquelles. « L’horreur de l’incarcération peut prendre plusieurs formes, parfois plus douces avec les médicaments… et donc plus difficiles à saisir et à faire changer » (Mounia Ahammad, lors du débat). Mais la relation au patient est plus couteuse… Cela suggère aussi que la maladie mentale se traite comme toute autre maladie. Un pas en avant, un pas en arrière… Et une lecture politique en guise d’éclairage.
(R)évolutions pour les jeunes « délinquants », l’expérience du foyer de Vitry
Alain CherbonnierMémoire de sauvageons, de S. Gilman et T. de Lestrade (52′, France, 2002), raconte l’histoire du CFDJ de Vitry, un foyer d’accueil pour jeunes délinquants. Pas n’importe quel foyer d’accueil : il naît en 1950, au moment où une nouvelle loi d’aide à la jeunesse parie sur l’éducation plutôt que sur la répression. Et pas n’importe quelle équipe non plus : le directeur est Jo Finder, un type hors du commun, appuyé par le célèbre psychiatre Stanislas Tomkiewicz, familièrement appelé « Tom ».Il y a les techniques d’expression : le dessin, le film, le slam avant la lettre, le sociodrame… Il y a la psychothérapie individuelle. Il y a un régime de semi-liberté tel que certains jeunes délinquants sont déconcertés et soupçonnent une arnaque. Il y a l’attitude de Jo, qui aime les prendre à contre-pied (« Tu piquais des bagnoles ? On va t’apprendre à voler sans te faire prendre ! ») mais est disponible pour eux à tout moment. Un ancien du foyer, Michaël Serejnikoff, à son entrée, se demandait à qui il avait affaire – et ses suppositions n’étaient guère flatteuses. Avec le recul, il parle d’un « apostolat ».Mais surtout il y a le temps. Il faut le temps : ce leitmotiv revient sans cesse dans le film. Pour paraphraser Ferré, on pourrait dire « avec le temps, va, tout s’en va »… Mais ce n’est pas magique, il ne faut pas croire, au vu des résultats remarquables obtenus en termes de réinsertion sociale, que c’est facile : ces petits gars-là sont des durs à cuire, il y en a un qui se livre à un saccage en règle, brisant 38 fenêtres !La punition ? Jo « leur fait la gueule ». Quand c’est le seul adulte qui vous porte attention et respect, qui s’intéresse à vous et non à ce que vous avez fait, ça porte. Michaël, sourire et regard doucement ironiques, après avoir haussé les épaules, baissera la garde et admettra : « Ben oui, ça fait quelque chose. » Il est devenu intermittent du spectacle, il n’a pas gardé le contact avec Jo : « Pas besoin. On ne l’oublie pas. ». D’autres anciens du foyer ont trouvé leur place dans la société. Sur 400 jeunes accueillis (souvent pendant trois ans ou plus), seuls 7 ou 8 auront finalement été exclus, quand l’équipe n’en pouvait plus.Si vous trouvez que c’est idyllique, rassurez-vous, le CFDJ a été victime de son succès : recevant de plus en plus de jeunes très violents, l’institution vivra un tel déséquilibre qu’elle devra fermer ses portes en 1983.Au cours du débat qui suit la projection, une question surgit rapidement : cela serait-il encore possible aujourd’hui ? Il est vrai que, dans les années 50, après les désastres de la décennie précédente
, la société était optimiste, on croyait aux valeurs issues de la résistance (cf. Stéphane Hessel). Aujourd’hui, avec la banalisation des drogues, le chômage de masse, les restrictions budgétaires tous azimuts, le retour du scientisme psychiatrique, le contexte est franchement gris. Cependant, relève Christine Vander Borght, il existe ici et maintenant des équipes qui travaillent dans le même esprit. N’empêche : au-delà du professionnalisme, ce travail exige un engagement, un courage, une générosité qui représentent autant de défis.
Le traitement médiatique de la santé mentale dans les ‘60
Manon Gobeaux et Juliette VandervekenLors de la seconde journée, on change d’angle d’attaque pour la rétrospective. Chacun des films est un morceau d’un puzzle qui donne un certain aperçu de la vision, notamment médicale, de la folie et des maladies mentales.Avec « Les maladies mentales – Point de la médecine » de P. Danblon (archives RTBF, 78’, Belgique, 1964), il est question de revenir sur le traitement journalistique des maladies mentales en Belgique en visionnant un reportage de la RTBF datant de 1964. Comment montrait-on la psychiatrie à l’époque ?Un constat : les journalistes prenaient davantage le temps, à l’époque, dans la construction des émissions pour comprendre un sujet et le traiter. A la différence de l’actualité chaude, on prend le temps d’enquêter sur le sujet. D’ailleurs, en tant que spectateur, on l’expérimente aussi : la parole est lente, posée, le langage châtié, la succession d’image semble au ralenti en comparaison au traitement actuel des images et des sujets.Notons que l’émission n’a pas fait l’unanimité au sein du comité lors du choix des films car il a soulevé la question de la manière dont le festival Images Mentales souhaite montrer la psychiatrie. Et cela amène aussi la question lors du débat qui a suivi la projection : avec ce qu’on filme aujourd’hui, comment nous verra-t-on dans 50 ans ? C’est l’occasion de s’interroger.
Au-delà des murs de l’asile
Manon Gobeaux et Juliette VandervekenAvec « Derrière les murs de l’asile » de S. Nay (archive RTBF, 47’, Belgique, 1973) et « Le psychiatre, son asile et son fou » de P. Manuel et J.Péché (archive RTBF, 66’, Belgique, 1971), on nous propose ensuite de sauter à la décennie suivante et de garder le focus sur la Belgique. A partir des années ’70, un virage s’amorce : les questions liées aux maladies mentales, à l’enfermement et à la folie deviennent une problématique davantage traitée dans les faits de société. Les mouvements de l’antipsychiatrie, de mai 68… sont passés par là. Le regard devient plus social et sociétal.Les deux reportages sont très contrastés… mais la thématique de l’exclusion les réunit incontestablement. Ce sont les murs de l’asile qui séparent. Au dehors on trouve les gens « normaux » et dedans les aliénés.« Derrière les murs de l’asile » est consacré à l’institution « Les Marronniers » à Tournai, connue du monde psychiatrique belge. Il relate le travail d’une commission d’enquête publique organisée par l’association d’aide aux malades mentaux. « Une fois ou deux par semaine il m’arrive de rêver. Je vois des tabliers blancs, des fils barbelés, des murs sinistres, des barreaux aux fenêtres, enfin, je me revois enfermé. Disons que ça prend des proportions de cauchemars… c’est ce qu’il me reste de mon séjour à Tournai. » C’est sur ces mots que débute le film. Les mots d’un homme qui a fait partie des 1 200 à 1 300 malades que comptait l’institut, uniquement des hommes. C’est à l’époque, le plus grand institut d’état de Belgique, qui accueille dès lors les personnes dont on ne veut pas ailleurs : une section de défense sociale qui accueillait 450 internés reconnus irresponsables pour des délits qu’ils avaient commis. Les autres patients, ce sont les colloqués, ceux qui sont internés sur une mesure administrative, ou des personnes avec un handicap mental qui arrivent là, faute d’autre chose.Manque de moyens, manque de personnel, manque de place, manque de… Manque de beaucoup de choses ! C’est ce que clament les anciens patients et les médecins dont l’un, psychiatre aux Marronniers, répond aux journalistes : « Est-ce que vous avez l’impression dans les conditions actuelles que vous soignez les malades ? Quelques fois… très rarement. ». Ce médecin a pour lui tout seul une centaine de patients. Le désarroi s’exprime aussi chez les médecins en dehors des institutions psychiatriques. Que faire, que proposer comme solution à un patient qui a besoin de soins psychiatriques urgents, ponctuels et parfois pour une courte durée ? Dans la très grande majorité des cas, les médecins n’avaient que deux solutions : le retour à domicile ou l’hospitalisation. On colloque alors les patients en espérant « qu’ils ne s’incrustent pas », comme on dit à l’époque. Plus souvent gardés que soignés, les conditions de vie et de travail de l’institut rendent le chemin vers la guérison presque improbable. On assiste à « des hospitalisations à vie » comme nous, spectateurs, le qualifions parce qu’aucune famille n’a « réclamé » son fils, son frère, son père. Une situation illustrée par le discours d’un vieux monsieur qui devant la caméra déclare être entré aux Maronniers 53 ans plus tôt… Il avait 18 ans.Pourtant, des patients qui sortent de l’asile, il y en a. Ils sont difficiles à trouver mais ils existent. Ce sont des gens qui cachent leur passé en asile car rien n’est moins vendeur pour trouver un travail qu’une expérience de patient en institut psychiatrique… Comme le souligne la voix off du reporter « Le fou c’est toujours l’autre. Celui qui est anormal alors que moi bien sûr je suis normal et je le resterai ».Le second reportage « Le psychiatre, son asile et son fou » trouve son cadre dans un institut psychiatrique pour femmes à Louvain « avec comme guides trois psychiatres qui y travaillent mais n’ont pas toujours de certitude ou de réponse définitives à donner », dixit le « pitch » de la SONUMA. Le contraste avec le fonctionnement des Marronniers est surprenant. Les soignants sont proches des patientes, de leur environnement. Ici aussi, on rêve d’un fonctionnement « horizontal »… « utopique, car on sait qui garde les clés » soulignera un intervenant dans la salle.
Aujourd’hui… et demain ?
Alain CherbonnierDans une valse à trois temps, Images Mentales nous a emmenés hier (voir ci-dessus), puis aujourd’hui… et demain ? Retour sur deux moyens métrages et un spectacle vivant.
Aujourd’hui
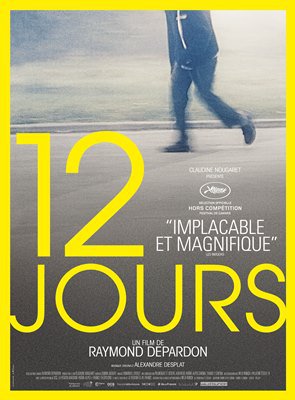
, on n’est plus à l’école ! » proteste un autre), c’est un film assez glaçant. Il est vrai que les actes qui ont motivé l’hospitalisation forcée de ces personnes sont parfois graves (tentative de meurtre, tentative de suicide et même parricide), leurs pathologies, lourdes (polytoxicomanie, délire). Mais on a le coeur serré quand cet homme dit : « Je suis fou, je suis malade mental. Je suis un sous-doué. » Ou quand cette femme au visage inexpressif a recours à une batterie d’arguments préparés afin de recouvrer la garde de sa fille.Au bout du compte, l’impression qui subsiste est que la loi de 2013, sans doute bien intentionnée, se révèle à l’usage presque cosmétique. Image trompeuse ? Peut-être le long défilé de justiciables, à la longue fastidieux, y est-il pour quelque chose. Dans « La permanence » (97′, France, 2016), Alice Diop met en scène la Permanence d’Accès aux Soins de Santé de l’hôpital Avicenne, à Bobigny. La PASS s’adresse aux primo-arrivants ; c’est la seule de ce type dans tout le département de la Seine-Saint-Denis. C’est dire que la salle d’attente ne désemplit pas.

« Ça me fait bizarre de donner des antidépresseurs dans une situation comme ça. C’est vraiment l’expression de notre impuissance. »
Quelques rapides portraits. Le Sri-Lankais qui soupire en racontant son histoire (il souffre de multiples fractures suite à un tabassage par les militaires) : « My life is very bad. » Le regard de cet homme !… Un Indien qui attend de savoir s’il sera régularisé : « Je dis au temps de passer mais il n’écoute pas »… Mamadou est réjoui : il a enfin obtenu le statut de réfugié. Mais il n’a toujours ni logement ni travail. Un patient, pour remercier le médecin, apporte à celui-ci, dans un emballage cadeau… une petite tour Eiffel : « Dès que je trouve un job, j’en apporte une plus grande ! »… Une Sud-Africaine est venue en Europe en catastrophe, avec un seul de ses enfants. Quand on ouvre son dossier médical, elle revit ce qui s’est passé, éclate en sanglots, pousse des gémissements, une autre dame vient lui toucher les épaules. Le médecin, à sa consoeur : « C’est vraiment une vie de merde qu’elle a eue. »Dans le débat qui suivra, Pascale De Ridder soulignera la violence du système, à laquelle les soignants eux-mêmes sont confrontés : « Depuis 2011, ça n’a fait qu’empirer. Le système se durcit de plus en plus. Notre société est en train de constituer quelque chose de délétère. »
Demain ?
Sur un mode plus drôlatique, Psychomaton 3000 fait écho à cette réflexion. C’est une pièce conçue et jouée par sept étudiants en psychiatrie de Lille – ce qui donne quelque confiance en la future génération de psychiatres. En quelques mots : on est en 2084 (tiens tiens, ça ne nous rappellerait pas quelque chose?) ; avec les conflits sociaux en tous genres, la faillite de la Sécu, etc., les troubles mentaux des gens sont en hausse et, désormais, pris en charge par un dispositif entièrement automatisé, oeuvre des laboratoires Benzo… Quand un psychiatre intervient, c’est sans voir le patient, qui est soumis à un questionnaire-type incroyablement simpliste et brutal – mais que l’on apprendra ensuite inspiré d’un authentique questionnaire !Quatre personnes défilent dans le Psychomaton et, au début, on rit beaucoup même si l’humour est noir. Ça se gâte quand un père surgit avec sa fille suicidaire ; il parle mais la machine ne l’écoute pas, il est éperdu, il reçoit l’ordre de « communiquer ». L’échec attendu de cette « communication » père-fille débouchera sur une hospitalisation presque forcée de cette dernière.Le quatrième patient est un habitué, il est amoureux de « la petite voix », celle de la machine, et résiste aux injonctions qu’on lui impose : il ne veut pas être soigné, il veut aller prendre un verre avec la femme de « la petite voix » ! Cela se terminera très mal pour lui, car le Psychomaton n’accepte pas que l’on refuse la norme.La pièce est évidemment une satire, mais toute caricature part de la réalité, une réalité contemporaine faite de toujours plus de rendement, d’efficience, de standardisation, d’automatisation. Ici, le contact humain, le lien, la parole sont complètement absents. Notons toutefois qu’il n’est pas besoin de technologie sophistiquée pour se heurter à la froideur institutionnelle, à la distance bureaucratique.
Rencontre avec Martine Lombaers, coordinatrice de Psymages
ES : Cette année, c’était la 10è Edition des Rencontres Images Mentales…Très souvent, les gens parlent de « festival » en évoquant « Images Mentales ». Or, ce sont des « Rencontres ». Ici, nous ne décernons pas de palmarès ou de prix, ce n’est pas dans notre optique. Notre souhait est de permettre à un public (de professionnels du secteur de la santé mentale, des étudiants, le grand public…) de se rencontrer et d’échanger à partir de films traitant de la santé mentale, de la folie, etc.ES : comment est née l’asbl Psymages, organisatrice de ces « Rencontres » ?
et toujours alimentée à ce jour. Elle comporte plus d’un millier de titres !ES : Vous aviez donc matière à exploiter…Oui, nous nous sommes très vite rendus compte qu’on avait une mine d’or entre les main! Déjà en ’98, nous avions organisé une séance de projections intitulée « Images des uns, regards des autres ». Nous voulions sortir du cadre des images « à sensation » qu’on retrouve dans les journaux télévisés et qui alimentent toutes sortes de préjugés habituels sur la folie, les psychopathes, etc.Le titre « Images des uns, regards des autres » a été choisi car il y avait déjà la volonté d’une part, de projeter des films d’ateliers, et d’autre part de croiser les regards des cinéastes avec une lecture psy. Ça permet d’interroger le désir du cinéaste, ce qu’il a voulu mettre en lumière, le choix du sujet, le rapport filmeur-filmé, etc.D’autres opportunités se sont présentées ensuite. Et, en 2005, ce fut la première édition d’ « Images Mentales ». On a pioché dans la réserve pour la programmation, mais elle se composait surtout à ce moment-là de films français diffusés dans le cadre du festival de Lorquin.ES : « Images Mentales » est aussi une collaboration avec La Vénerie, centre culturel de Watermael-Boitsfort. Progressivement est venue l’idée de s’associer à un centre culturel pour s’ancrer davantage dans une démarche de collaboration et s’ouvrir au public francophone bruxellois et d’ailleurs. Dès le départ de notre collaboration avec La Vénerie, ils se sont inscrits comme partenaires du projet avec un soutien actif.De plus, l’Espace Delvaux (où se déroulent les projections) répondait également à d’autres impératifs qu’on s’était fixés : bénéficier d’une salle de projection professionnelle, avec un système de sonorisation de qualité, des places assises « comme au cinéma », etc. C’est primordial pour nous d’offrir un cadre idéal pour mettre en valeur le document audiovisuel : pour le rendu des films, et notamment la mise en valeur des films d’ateliers, pour le confort des spectateurs, pour le respect des auteurs, etc.ES : Quel public retrouve-t-on ? Il est de plus en plus large. Ce ne sont pas que des personnes du secteur de la santé mentale, mais aussi des personnes attachées à l’espace culturel… Ce qu’on propose n’est pas uniquement pour un public d’avertis, c’est beaucoup plus ‘grand public’ que l’on pense.Et les « Rencontres » sont aussi un moment particulier où il est intéressant de venir avec les patients. C’est l’occasion d’une sortie, on se retrouve autour de la thématique de la santé mentale mais hors du cadre de l’institution. Ça crée aussi un pont avec la société civile.ES : Comment les films sont-ils sélectionnés ? Comment choisissez-vous les thématiques ? On démarre chaque nouvelle édition avec une page blanche. Chaque membre du comité
apporte ce qu’il trouve, on prend le temps d’aller chercher dans différents lieux comme le festival Imagésanté par exemple, je reçois tout au long de l’année des films de cinéastes, de maisons de production… On visionne, on met de côté… mais nous n’avons pas de grille formatée avec un objectif précis. Une année, nous avons essayé de nous pencher sur la thématique de la souffrance au travail… et on s’est très vite rendus compte qu’on s’enfermait, qu’on voulait absolument faire rentrer les films dans notre cadre. On a décidé de tout reprendre à zéro. On finit toujours par trouver une trame, un fil rouge aux projets présentés, un lien ou une thématique qui se dégage.ES : Dans la programmation, on retrouve chaque année une journée consacrée aux films d’ateliers.C’est la tradition, le vendredi est la journée dédiée aux usagers, moment où ils peuvent montrer leur travail et échanger autour de celui-ci. Le fait de pouvoir le présenter à un public, sur grand écran, c’est une reconnaissance importante pour eux. Les institutions ont besoin de ce moment. Ca alimente aussi le travail des autres ateliers.Quand on a démarré à l’époque, on avait dû faire venir des films d’ateliers français, il n’y avait que trois ateliers en Belgique. Mais d’année en année, le public des institutions venait voir les films d’ateliers et sortaient de la projection avec l’idée de proposer eux aussi un film l’année suivante. Ce ne sont pas moins de 14 institutions belges aujourd’hui qui viennent proposer des films d’atelier, nous sommes ravis de cette évolution.< Mise en exergue > Le fait d’être un moteur pour la création, ça donne tout son sens aussi à ces « Rencontres ». Chaque édition devient un moteur pour la création et la production d’autres films d’ateliers, de spectacles, etc. <Fin de mise en exergue>ES : Pour cette édition spéciale des 10 ans, qu’aviez-vous prévu ? Et quelles sont les nouveautés que vous souhaitez perpétuer pour les prochaines éditions ?A l’occasion de cette 10ème édition, nous avons voulu prendre plus de temps (5 journées et 5 soirées). Très vite est apparue l’idée de faire une incursion dans le passé en sortant des archives qu’on ne voit pas ou peu. C’est l’occasion de mesurer le chemin parcouru, de s’interroger sur les pratiques d’hier et voir comment les questions de santé mentale étaient traités à l’époque.Cette année, nous avons aussi ouvert le champs des intervenants avec des sociologues, anthropologues, des philosophes, des usagers (avec le groupe « Interface » notamment), un chroniqueur… Les lectures différentes étaient très riches.Enfin, on a inclus dans la programmation des spectacles vivants. C’était magnifique ! Pour la clôture, notamment, il y a eu le spectacle « Anosognosies » de la Compagnie « l’Appétit des Indigestes », avec une standing ovation de 270 personnes. La particularité de cette troupe est d’associer des usagers, des comédiens professionnels, des soignants, des infirmiers et toute personne qui souhaite s’associer au spectacle. Le fond de leur travail porte sur la perception de la maladie mentale, du malade mental, de la perception de la folie dans la société…On verra ce que les prochaines éditions nous réservent, rien n’est encore décidé. Les portes sont ouvertes.
Pour mémoire, le terme « sauvageons » fut popularisé en 1999 par Jean-Pierre Chevènement, à l’époque Ministre de l’Intérieur, pour qualifier les jeunes délinquants.
Entre 1940 et 1944, des milliers de malades mentaux – dont Camille Claudel – meurent dans les hôpitaux psychiatriques, oubliés et sous-alimentés.
Site des archives audiovisuelles de la RTBF
Il s’agit en fait du collège de trois psychiatres qui établit le diagnostic. Mais la confusion en dit long sur la distance entre l’univers médico-judiciaire et le commun des mortels.
une équipe très informelle en fait, formée de gens de tous horizons : des personnes détachées des institutions de santé mentale, de Point Culture, mais aussi des personnes qui viennent à titre privé car elles sont intéressées, qu’elles soient usager ou non. C’est un noyau d’une dizaine de personnes.

