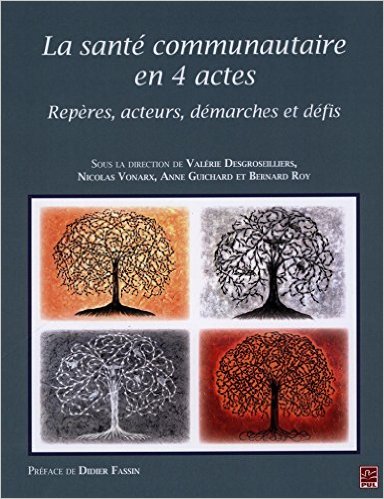Les Presses de l’Université Laval, à Québec, viennent de publier un ouvrage collectif intitulé La santé communautaire en 4 actes. Lecture attentive (mais non exhaustive) d’un ouvrage foisonnant.
Dès les premières lignes du prologue, Bernard Roy situe les enjeux en évoquant sa conviction, il y a vingt ans d’ici, «qu’une distinction fondamentale existait entre santé publique et santé communautaire». (Houlà, ça va déplaire à certains.) Il travaillait alors comme infirmier auprès d’habitants dans une réserve indienne, au Canada. Mais, un jour, le vieux William lui demande: «Pourquoi me nommes-tu Montagnais, Indien ou Amérindien? Ce sont les Blancs qui nous nomment ainsi. Je suis un Innu. C’est ainsi que nous nous nommons entre nous… Innus!»
Quelque chose d’essentiel est déjà dit: le travail communautaire, ça commence par se décentrer, prendre distance avec son statut de professionnel ou d’expert, se demander à qui on s’adresse, comment on leur parle, à ‘ces gens-là’, habitants, patients, usagers. Comment on parle d’eux. Comment ils parlent d’eux et entre eux. S’interroger. Écouter. «Je prenais la mesure de mon ignorance envers ces gens que, sans discernement et assurément bien à l’aise, je nommais autochtones. J’ignorais tout de leurs rêves, de leurs espoirs et désespoirs, de leurs souffrances, de leurs victoires et défaites, de leurs obligations, de leurs plaisirs et déplaisirs, de leur humour, de leurs amours… J’ignorais leur quotidien, l’odeur du repas qui mijote, la famille attablée…»
D’emblée, la barre est donc placée très haut. Les 350 pages qui vont suivre (une cinquantaine de contributions, plus de 70 auteurs) tiendront-elles cette promesse implicite? On va voir. Mais, ce genre d’ouvrage étant impossible à résumer, je me permettrai d’aller picorer çà et là ce qui a retenu plus particulièrement mon attention. Pour situer mon point de vue, les fidèles lecteurs de cette revue fouilleront dans leur collection pour y trouver un article que j’ai publié jadis (n° 153, novembre 2000, pp. 10-12) et dont je ne renie pas une syllabe. Ah, désolé: il n’est pas sur le site… Par contre, on peut en trouver deux autres, plus récents, sur bruxellessante.org
.
Précisons quand même que, pour moi, l’adjectif ‘communautaire’ ne renvoie pas à un ensemble identitaire prédéterminé et fermé, mais à une dynamique collective qui se construit dans un espace social donné sur base d’intérêts ou de buts communs, se développe et vit pendant une durée variable.
Des repères
L’introduction générale cite, pour définir la santé communautaire, des «repères largement véhiculés» (p. 1), mais peut-être qu’ils ont été trop véhiculés, justement: c’est l’autoroute, tout le monde y roule! Allons voir sur les routes de campagne, les sentiers non battus.
Anne Plourde (pp. 24-28) fait appel à deux modèles de prestation des soins de santé nés au Québec au tournant des années 60-70: celui de la Clinique Communautaire, initiative citoyenne caractéristique d’une contestation du système et de la culture médicales, et celui des CLSC, «initiative bureaucratique et gouvernementale». La Clinique Communautaire de Pointe-Saint-Charles, qu’étudie plus particulièrement l’auteure, se caractérise par quatre traits spécifiques: une critique radicale de la médecine libérale, une remise en question de l’organisation hiérarchique du travail, un mode de gestion résolument démocratique, et surtout un refus de la médicalisation des problèmes de santé, qui sont envisagés dans une perspective socio-politique.
Oufti, ça ne nous rappellerait pas les débuts des maisons médicales en Belgique? Mais l’auteure pointe que les initiatives communautaires elles-mêmes ont leurs limites, s’institutionnalisent et tendent à perdre leur caractère radical.
Amélie Perron (pp. 29-33) note d’emblée que la confusion persiste entre les termes de santé communautaire, santé publique et santé des populations. Ce qui me ramène en 1998: l’asbl Question Santé m’avait confié le dossier ‘santé communautaire’ et je ne savais pas trop de quoi il s’agissait. Il m’a fallu deux ans de lectures, rencontres, travaux, interventions, pour que ‘mon franc tombe’, comme on dit à Bruxelles, et qu’à Grande-Synthe, aux Premières Journées de l’Institut Renaudot, je me fasse ma petite idée. Je pensais que ça s’était éclairci depuis. Pas sûr.
Le constat dont je suis parti en 2004 pour construire un module de formation/sensibilisation à la santé communaire (35 heures) et que je croyais dépassé depuis, semble toujours valable si l’on en croit plusieurs auteurs, notamment Louise Hamelin Brabant, Claudia Fournier et El Kebir Ghandour (pp. 59-64): concernant la santé communautaire, «rien n’est univoque et le flou conceptuel évoqué [plus haut] se retrouve abondamment dans la littérature, la pratique et les programmes de formation». Ces auteurs pensent «qu’au plan sociologique, ce qui est propre à la santé communautaire, c’est son rapport au social. Celui-ci est marqué par la participation des membres de la communauté dans l’identification et la définition de leurs problèmes, la réflexion et l’application des solutions ainsi que leur insertion dans une démarche de développement local.»
Ainsi, les membres de la communauté ne doivent pas être considérés comme objets d’étude ni même simplement «consultés» (par questionnaire d’enquête ou autre protocole) mais effectivement impliqués comme acteurs du processus à construire. Ce qui suppose aussi que les professionnels ne soient pas toujours seuls à la manœuvre et soient capables d’appuyer la population dans ses propres initiatives…
Des acteurs
Partant du terrain urbain de l’outremer français (Cayenne, Saint-Denis de la Réunion), Bernard Cherubini (pp. 86-90) renchérit en se référant à Baumann et Deschamps: «dans l’approche de santé communautaire, il ne s’agit pas de considérer les communautés comme de simples collectivités à l’échelle desquelles seraient administrés des soins. L’action de santé dans une perspective communautaire suppose que la communauté soit elle-même actrice, qu’elle participe réellement et que s’instaurent entre elle et les professionnels de santé des rapports basés sur un partage de savoirs, une collaboration, voire un engagement communautaire, qu’elle s’organise à des degrés variables pour trouver des réponses à ses problèmes collectifs de santé.»
Engagement communautaire? Hélène Laperrière montre ce que peut signifier concrètement cette expression, dans un article dont il faut citer le titre et recommander la lecture (le défi lancé par le prologue y est pleinement relevé): ‘Débrouillardise, stratagèmes et actes de pouvoir de populations rendues invisibles dans le débat de la santé publique/communautaire: savoirs métis’ (pp. 91-97). Tout un programme! Le titre seul avait déjà retenu mon attention et m’en avait rappelé un autre: ‘Héros métis. Jeunes bruxellois passeurs de monde’. La lecture de l’article m’a ensuite rappelé une expression entendue il y a bientôt vingt ans dans la bouche de Claude Jacquier: il faut «des francs-tireurs pour les quartiers en crise».
Bien que Laperrière n’intervienne pas exclusivement en ville, mais aussi voire surtout en milieu rural, dans la région amazonienne, toujours auprès de populations pauvres, exploitées, le nom de franc-tireur lui va comme un gant: elle joint une extrême rigueur théorique, éthique et méthodologique à une immersion (non sans risques) dans ces populations et à un regard critique sur l’universalisme universitaire.
Quelques pages plus loin (pp. 104-112), vous trouverez la longue et passionnante interview de Gilles Julien, pédiatre québécois qui travaille en milieu urbain, dans des quartiers délaissés et avec des familles confrontées à l’inéquité sociale (loyers inabordables, logements insalubres, pauvreté chronique).
Il pointe la bureaucratisation des structures top-down du genre CLSC mais aussi l’importance, au sein même de ces structures, d’individus visionnaires (sic), capables de «sortir du cadre» imposé. Il plaide surtout pour le contact direct avec les familles, pour la présence dans la rue, les relations interpersonnelles, bref le travail de terrain («Tout s’est construit de manière très ground dans la communauté»). Pour lui, médecine sociale et santé communautaire, même combat.
Il considère aussi que, chez les professionnels, le travail communautaire est inséparable de l’advocacy (qui n’est pas que le lobbying du pauvre, c’est aussi savoir taper du poing sur la table). Et de l’empowerment, ou pouvoir d’agir soi-même et collectivement: «Il y a plusieurs choses qu’on ne fait pas pour les parents, qu’on ne veut pas faire parce qu’on veut qu’ils le fassent par eux-mêmes, qu’ils apprennent. Nous les accompagnons, on va les dépanner, mais c’est eux autres qui vont finir par le faire.»
Maxime Amar signe un article très court et percutant (pp. 138-141) qui démarre sur une vignette clinique, dans le service d’urgences où il travaille. Cela mène à un plaidoyer pour la santé communautaire vue comme l’oeuvre d’un réseau multidisciplinaire et intersectoriel, modèle qui est le mal-aimé des politiques publiques.
Ce médecin urgentiste est rejoint, dans sa critique du cloisonnement institutionnel, par un infirmier de rue, Frédéric Launay (pp. 152-157), qui s’est heurté aux ‘cases’ dans lesquelles les dispositifs rangent les individus: «Je devais théoriquement m’intéresser à un public sans domicile fixe et, dès lors qu’un individu disposait d’une adresse, il était associé à un secteur géographique et relevait par conséquent d’un maillage de services prédéterminé duquel j’étais de facto exclu; il sortait donc automatiquement de mon champ d’intervention.»
S’ensuit une analyse très solide où l’auteur, s’appuyant sur Robert Castel mais aussi Pascal Durand, décortique la perversité de la classification sociale et déconstruit les stéréotypes dans lesquels «les nouveaux mots du pouvoir» enferment individus et groupes.
Des défis
Plusieurs auteurs mettent le doigt là où cela peut faire mal: la santé communautaire ne dépend pas seulement de la bonne volonté des professionnels et de leur positionnement vis-à-vis des membres d’une communauté; elle dépend aussi de la santé démocratique d’un pays (étant entendu que la démocratie ne se résume pas à des élections libres).
Jacky Ndjepel et Henri Bitha (pp. 283-287) montrent le chemin qu’a fait et que fait encore le Cameroun – où l’unipartisme a régné de 1960 à 1990 – en créant des structures qui se présentent comme des lieux d’expression pour la communauté. Ils notent cependant avec une remarquable prudence: «Dans le contexte camerounais, nous estimons que c’est à travers ces instances que l’approche de santé communautaire pourrait prendre forme, en étant d’une part modulée par une organisation sanitaire théoriquement favorable à son émergence, et d’autre part associée à une liberté d’expression concédée par un environnement démocratique en émergence.»
Dans ma propre contribution (pp. 288-291), je pointe le risque trop réel que la participation, tant vantée, ne soit qu’un des nouveaux mots du pouvoir. Et camoufle le paradoxe que peut résumer la question suivante: quelle participation pour les exclus – sans papiers, sans abri, détenus, chômeurs de longue durée, personnes en grande pauvreté et/ou du quart-monde?
Michel Joubert (pp. 292-298) situe sa réflexion dans le contexte des villes françaises, où l’action publique se voit reconfigurée depuis une quinzaine d’années. L’enjeu est double: l’action sur les déterminants sociaux qui produisent des inégalités de santé, et la place des personnes qui devraient bénéficier de la réduction de ces inégalités.
Mais les initiatives de promotion de la santé, de prévention ou de réduction des risques se heurtent au système politico-institutionnel, qui reste très segmenté et médico-centré. Des changements systémiques seraient nécessaires pour impliquer, autrement que de façon marginale, les acteurs de terrain, qu’ils soient habitants ou professionnels. Les expériences entreprises, depuis plus de vingt ans, en contact direct avec les populations continuent à souffrir d’un manque de reconnaissance et de légitimité. Dans le champ de la santé comme dans d’autres (pensons à l’éducation), c’est une logique top-down qui persiste à s’imposer.
À partir de deux cas fictifs mais représentatifs, Daphney St-Germain (pp. 305-310) illustre les difficultés de faire exister la collaboration interprofessionnelle en milieu communautaire, particulièrement lorsqu’il s’agit de personnes vulnérables. Alors que tout le monde s’accorde à reconnaître l’interdisciplinarité comme incontournable, les divers modes d’organisation institutionnels sécrètent des pratiques professionnelles qui répondent mal à la réalité de personnes comme celles qui sont en réadaptation physique ou aux prises avec l’itinérance ou la toxicomanie.
Rideau?
Annoncée d’emblée, tout au long de l’ouvrage court la distinction – qui peut tourner à l’opposition – entre santé publique et santé communautaire. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à la fin la question n’est pas tranchée.
Pour opérationnaliser cette distinction, on pourrait peut-être proposer des outils d’analyse très pragmatiques. Par exemple: à quels types de projets et programmes vont les financements? Ou encore: quels modes d’évaluation sont favorisés?… On pourra trouver cette double suggestion caricaturale, simpliste. Mais est-elle si lointaine de la distinction en trois points proposée par Hélène Laperrière au départ de Bernard Goudet (p. 92)?
Par ailleurs, elle repose sur un questionnement à la fois méthodologique et éthique qui vise le choix des instruments de mesure et des critères de sélection des projets. Questionnement ancien mais toujours pertinent, et révélateur de décisions politiques.
Référence de ce remarquable ouvrage: Valérie Desgroseilliers, Nicolas Vonarx, Anne Guichard et Bernard Roy (dir.), La santé communautaire en 4 actes. Repères, acteurs, démarches et défis, Québec, Presses de l’Université Laval, 2016. Site de l’éditeur: www.pulaval.com
Je ferai notamment l’impasse sur la troisième partie, qui décrit non moins de 17 démarches de «santé communautaire» à travers le monde. À chaque lectrice ou lecteur d’y piocher selon ses centres d’intérêt.
Ce n’est pas tout à fait exact. La base de données des articles d’Éducation Santé a démarré en janvier 2001 (numéro 155), mais vous pouvez retrouver l’intégralité des numéros 1 à 154 en PDF via le site sur www.educationsante.be/rechercher/archives. Y compris le texte d’Alain Cherbonner (ndlr).
‘Pratiques communautaires aujourd’hui à Bruxelles’, dossier en deux parties paru dans Bruxelles Santé à la fin 2010.
Centres Locaux de Services Communautaires. Nous ne connaissons pas d’équivalent en Belgique francophone.
Ce programme, initié dans la Vienne à la demande du CRES de Poitou-Charentes, a été reconduit à cinq reprises, d’abord à Poitiers, puis deux fois à Bruxelles et deux fois dans le Brabant wallon.
Auteure: Véronique Georis. Voir Bruxelles Santé n° 71, septembre 2013, dans Bruxelles Santé à la fin 2010 : https://questionsante.org/nos-publications-periodiques/bruxelles-sante/anciens-numeros/bs-71/metissages.
Pascal Durand (dir.), Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaire critique, Bruxelles, Éd. Aden, 2007.