Un check up de notre système de santé en 121 indicateurs
Le 30 Déc 20
Publié dans la catégorie :
Notre système de santé est régulièrement soumis à un « check up » de ses performances. C’est le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) qui tient le stéthoscope, en collaboration avec Sciensano, l’INAMI et le SPF Santé publique. Pour cette quatrième édition, 121 indicateurs ont été passés au crible. Le résultat : une analyse en 5 dimensions transversales et 5 thématiques spécifiques, qui constitue un véritable tableau de bord du système. Le rapport signale les points forts et faibles par des feux verts et rouges. Les feux verts vont, par exemple, au taux de survie à 5 ans après un cancer colorectal, à la mortalité néonatale ou au recours aux médicaments bon marché. Les feux rouges nous alertent sur la surconsommation d’antibiotiques, la baisse de la vaccination contre la grippe des personnes âgées ou encore les perspectives de renouvellement en médecine générale. Un tableau de bord belge dans un cadre européen.
Le rapport sur la performance du système belge de soins de santé (Health system performance assessment – HSPA) s’inscrit dans une démarche internationale de monitoring des systèmes de soins à travers l’Europe. Il permet aux autorités des différents pays de planifier leur stratégie de santé, d’établir des comparaisons entre pays et de se fixer des objectifs à atteindre. L’objectif final étant de pouvoir offrir à la population un système de santé de grande qualité à un coût abordable.
Le rapport HSPA belge se construit selon cinq dimensions : l’accessibilité, la qualité, l’efficience, la soutenabilité et l’équité des soins. Par ailleurs, cinq thématiques de soins particulières sont mises sous la loupe : les soins préventifs, les soins de santé mentale, les soins aux personnes âgées, les soins de fin de vie et – nouveau dans cette édition – les soins à la mère et au nouveau-né.
Un site internet dynamique
Autre nouveauté : un site internet healthybelgium.be réunit le rapport HSPA, celui sur l’état de santé de la population (Health Status Report, réalisé par Sciensano) et celui sur les variations de pratiques de soins (réalisé par l’INAMI). Ce site internet permettra à tout un chacun de se renseigner directement sur l’évolution de très nombreux paramètres – dont les 121 indicateurs HSPA – et même d’en télécharger les données à partir de graphiques dynamiques. Une mine d’informations pour les chercheurs en santé publique, les décideurs politiques, les journalistes, les étudiants et tous les curieux intéressés par le sujet.
Des soins efficaces mais souvent peu adéquats
Que montrent les 121 indicateurs qui constituent ce rapport ? En ce qui concerne la qualité des soins, on notera que leur efficacité est plutôt bonne, que leur sécurité est moyenne (avec un feu orange pour les infections nosocomiales) et qu’en ce qui concerne leur adéquation (leur conformité aux recommandations de bonne pratique), quelques feux rouges doivent attirer notre attention, notamment en matière de prescription d’antibiotiques. On notera toutefois que plusieurs indicateurs, dont l’utilisation inadéquate de radiographies de la colonne vertébrale, amorcent une tendance vertueuse.
Accessibilité et équité
Les dépenses de santé totales du pays représentent 10 % de notre produit intérieur brut. Ce chiffre est stable depuis 2009 ; il est légèrement supérieur à la moyenne européenne. Notre système de santé peut être considéré comme relativement accessible, grâce à notre assurance maladie obligatoire, doublée de filets de sécurité sociaux pour les revenus les plus faibles (interventions majorées, maximum à facturer). La contribution personnelle par habitant diminue légèrement mais la proportion des personnes qui ont dû reporter des consultations médicales pour des raisons financières reste plus élevée que la moyenne européenne, surtout pour les catégories sociales les plus défavorisées.Pour ces mêmes catégories défavorisées, certains autres points restent problématiques : moindre participation au dépistage du cancer, fréquence moins élevée de visites chez le dentiste, consommation plus élevée de médicaments. Le KCE publiera plus tard cette année des analyses approfondies sur l’équité dans l’accès aux soins, réalisées grâce au couplage des données de santé à d’autres données socio-économiques (revenus, travail).
Trop peu de médecins généralistes
Le chapitre du personnel qualifié disponible reste délicat. Les indicateurs relatifs à la médecine générale et aux soins infirmiers mettent en question la capacité de la Belgique à faire face au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques. Le nombre de médecins généralistes en exercice pose problème, mais aussi leur âge moyen. Contrairement aux besoins évalués par la commission de planification, les jeunes diplômés s’orientent toujours trop vers la médecine spécialisée au détriment de la médecine générale (mais cette situation semble s’améliorer). Petite consolation : l’utilisation des dossiers médicaux informatisés progresse bien et le recours aux médicaments bon marché continue à augmenter.
Dans les hôpitaux, les postes en personnel infirmier sont difficiles à pourvoir, de quoi alimenter une réflexion sur la politique de rétention de ce personnel qualifié.
Personnes âgées : préparer le papy boom
Dans les maisons de repos pour personnes âgées, on prescrit encore trop de médicaments (surtout les anticholinergiques, antidépresseurs, neuroleptiques). Par contre, le taux de vaccination contre la grippe y est plus élevé qu’à domicile. Les places disponibles pourraient être mieux utilisées ; elles sont souvent occupées par des personnes peu dépendantes pour qui il serait plus utile de développer des formes alternatives d’hébergement plus adaptées. De façon générale, le nombre de gériatres reste trop faible dans notre pays.En ce qui concerne les soins en fin de vie, on observe une progression du recours aux soins palliatifs, mais l’hôpital demeure le lieu de décès le plus fréquent pour les personnes atteintes de cancer, alors que ce n’est pas le souhait de la majorité d’entre elles.
Prévention et santé mentale peuvent mieux faire
Les soins de santé mentale restent les parents pauvres du système, avec des délais d’attente parfois considérables avant un premier contact. Les prescriptions d’antidépresseurs continuent à augmenter, comme partout en Europe, mais les chiffres belges restent plus élevés que la moyenne, surtout en Wallonie.Les soins préventifs décrochent aussi un score plutôt médiocre. Seule la couverture vaccinale des nourrissons atteint un niveau acceptable. La vaccination des adolescents contre la rougeole est trop faible en Wallonie et à Bruxelles et celle contre la grippe est insuffisante chez les personnes âgées dans les trois régions. Le dépistage du cancer du sein – surtout le dépistage organisé – est trop peu suivi, en particulier à Bruxelles et en Wallonie.
Mère et nouveau-né
En matière de soins à la mère et au nouveau-né, notre pays atteint aujourd’hui un taux favorable de mortalité néonatale. L’induction de l’accouchement et l’épisiotomie systématique sont encore trop souvent pratiquées, mais la situation s’améliore. Le nombre de visites prénatales est loin d’être optimal, souvent trop élevé, mais parfois aussi trop faible pour les femmes des catégories sociales les moins favorisées. Enfin, certains tests de dépistage en cours de grossesse sont surutilisés (toxoplasmose, cytomégalovirus).
Vue d’hélicoptère
L’objectif premier d’une évaluation de la performance du système de santé n’est pas de distribuer des bons et des mauvais points, mais d’offrir une vision large et régulièrement remise à jour de l’ensemble du système. Les données analysées datent parfois de plusieurs années, ce qui est un délai normal quand on utilise des bases de données administratives. Certes, cela ne permet pas de prendre en compte les modifications récentes de stratégie. Il reste néanmoins intéressant de voir l’évolution dans le temps des indicateurs, pour vérifier qu’une politique donnée porte ses fruits sur le long terme, ou pour constater, au contraire, qu’une situation s’est détériorée depuis la dernière mesure.
Pour l’avenir : fixer des objectifs et intégrer les données
Un rapport HSPA n’a pas pour vocation de formuler des recommandations sur la politique de santé, mais le KCE insiste tout de même sur la nécessité, pour notre pays, de se doter d’objectifs de santé mesurables en tenant compte des points d’attention que le rapport met en avant. Une autre recommandation est de continuer à améliorer l’intégration des différentes sources de données relatives à la santé. En effet, la qualité des données et leur disponibilité en temps utile sont essentielles pour une évaluation telle que celle-ci. Utiliser un identifiant unique pour chaque patient permettrait de suivre chaque personne à travers l’entièreté du système de soins. Cette intégration des différentes données relatives aux patients ne peut toutefois pas faire l’économie d’un débat autour des enjeux éthiques, juridiques et techniques d’une telle entreprise, qui doit évidemment être conditionnée à un respect strict des données individuelles et de la vie privée.
Pour entrer en contact avec les chercheurs du KCE :
Karin Rondia, Communication scientifique KCE
Tél. : +32 (0)2 287 33 48
GSM : +32 (0)475 769 766
Email : press@kce.fgov.be













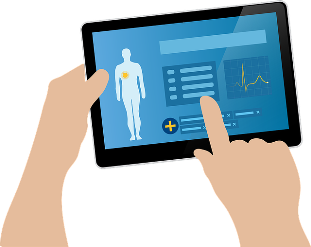
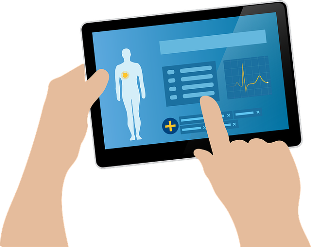













 Plus concrètement, ce dispositif prend la forme de rencontres entre un « capitalisateur » et les porteurs de projets, qui se construit en trois niveaux de capitalisation (qui va du plus simple au plus complexe) selon l’ampleur de l’action. Dans le premier niveau, par exemple, seul le porteur de projet est rencontré. Dans le second niveau, on prend en compte aussi les propos d’un partenaire qui a participé à l’action.
Plus concrètement, ce dispositif prend la forme de rencontres entre un « capitalisateur » et les porteurs de projets, qui se construit en trois niveaux de capitalisation (qui va du plus simple au plus complexe) selon l’ampleur de l’action. Dans le premier niveau, par exemple, seul le porteur de projet est rencontré. Dans le second niveau, on prend en compte aussi les propos d’un partenaire qui a participé à l’action.









