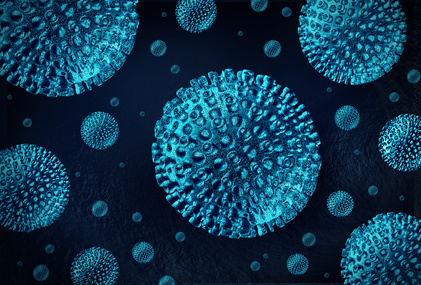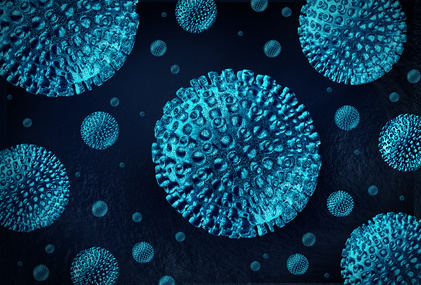À l’occasion de la Semaine européenne de dépistage du VIH et hépatites, menée à travers toute l’Europe du 20 au 27 novembre derniers, des acteurs de terrain et des fédérations concernés par ces questions ont cosigné une carte blanche à l’initiative de la FEDITO Bruxelles (Fédération bruxelloise des institutions pour toxicomanes) et du Réseau Hépatite C Bruxelles.
En Europe, 2,5 millions de personnes vivent avec le VIH, dont un tiers l’ignore. Plus de 28 millions de personnes sont atteintes d’hépatite virale, dont seule une petite partie est diagnostiquée et, encore beaucoup moins, traitée (3,5 % des hépatites C). Contrôler, faire régresser, ou même – dans le cas de l’hépatite C – vaincre ces épidémies est aujourd’hui, non seulement possible, mais surtout prioritaire au plan de la santé publique, vu leur place en tête de liste des causes mondiales de mortalité infectieuse. Il faut pour cela s’engager résolument dans la stratégie dite «test and treat».
Contrôler ces infections passe d’abord par la connaissance, par tous, des facteurs de risques et des moyens de se protéger. Puis, par le dépistage des personnes exposées, et enfin, par le traitement et le suivi des personnes infectées. Seule cette triple approche permettra aux personnes atteintes de vivre normalement, voire de guérir; et surtout, elle constitue la pierre angulaire du contrôle de l’épidémie. Il ne s’agit pas seulement de santé des populations, mais aussi de bonne gestion économique.
Car, si promotion de la santé, dépistage et traitement ont un coût non négligeable, celui-ci a toute chance de s’avérer beaucoup moins élevé que la gestion, à un stade et une ampleur plus avancés, d’une épidémie de toute façon incontournable et génératrice de complications sévères: ces virus sont devenus la première cause de transplantation hépatique, procédure sophistiquée, grevée d’une mortalité non négligeable et très coûteuse pour la collectivité, aussi en raison de la surveillance et des médications à vie ensuite nécessaires.
L’inventaire des pratiques les plus à risque semble d’emblée très stigmatisant: sexe non protégé, tatouage et piercing non stériles, injection de drogues. Mais en réalité, tout le monde est concerné. Il existe encore un réservoir important de patients non diagnostiqués qui ont été contaminés par des procédures médicales avant l’identification du virus de l’hépatite C (1990). Pensons aussi aux jeunes à l’entrée dans leur vie sexuelle active ou aux HSH, particulièrement exposés.
Tout le monde a avantage à ce que tous aient accès à l’information, au dépistage et au traitement, y compris et en priorité les groupes les plus à risque. Or ceux-ci, notamment les détenus, usagers de drogues, migrants, travailleurs du sexe, ne sont précisément ni les mieux informés ni certainement les plus privilégiés en matière de diagnostic et d’accès aux traitements.
Frileuse Belgique
De nouvelles molécules font espérer une éradication, au niveau mondial, de l’épidémie de l’hépatite C. Pourtant, leur prix exorbitant (à bien distinguer de leur coût réel, largement inférieur, même en y incluant recherche et développement) met au défi les systèmes d’accès aux soins, y compris dans les pays les mieux nantis. Ces traitements sont donc réservés aux personnes présentant une dégradation avancée de leur capital hépatique.
De même, en termes de VIH, les recommandations internationales de mise sous antirétroviraux des personnes porteuses du virus, dès leur diagnostic, ne sont pas d’application en Belgique, où il faut prouver une réduction déjà sérieuse des défenses immunitaires pour les obtenir. L’OMS recommande pourtant la mise sous traitement antirétroviral quel que soit l’état immunitaire de la personne. En outre le traitement agit comme moyen de prévention puisqu’une personne atteignant une charge virale indétectable ne transmet plus le VIH.
Il est donc incompréhensible que perdure un blocage dans la mise à disposition de nouveaux outils de dépistage fiables, ne nécessitant pas de prélèvement sanguin. Alors que l’usage de ces Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) se développe rapidement chez nos voisins, y compris en milieu d’aide non médicalisé, alors que les pratiques sur le terrain, dans certains groupes à risque, sont à l’autotest, l’usage de ces outils de dépistage reste non reconnu en Belgique.
De même, si, en 2015, il reste plus dangereux de s’injecter des drogues chez nous que dans bien d’autres régions d’Europe – au détriment des usagers mais aussi de leurs proches et de la société en général – c’est en raison du déficit persistant de reconnaissance et de financement dont souffrent des dispositifs de réduction des risques largement validés ailleurs.
Certes, l’érosion de la capacité des gouvernements nationaux à influencer la construction des prix des nouveaux médicaments dans un sens favorable à la santé publique est une question très complexe qui ne trouvera pas de solution rapidement. Mais il faut prendre acte que, pour la première fois à l’époque moderne, dans nos contrées privilégiées, un problème de santé publique est soumis drastiquement au tempo des marchés de façon aussi évidente…
Il est donc d’autant plus nécessaire et urgent de développer les dispositifs de prévention et de dépistage, très peu coûteux et à l’efficacité bien documentée dont nous disposons. Spécifiquement, les TROD, VIH, et hépatite C, devraient être promus sans délais, non seulement auprès des médecins, mais aussi en non médicalisé, auprès de toutes les associations en contact avec des groupes davantage à risque, moyennant formation des intervenants. Quant à l’autotest, il serait pertinent de l’encadrer de façon responsable, sachant qu’il est déjà disponible en France… et sur internet !
Plus généralement, une stratégie globale est encore à privilégier. Les plans fédéraux VIH et hépatite C sont loin d’être appliqués alors qu’ils ont été élaborés il y a plus de deux ans. Ils donnent pourtant les repères nécessaires au développement de stratégies de santé publique efficaces et efficientes. Pour cela, il n’est pas besoin de modifier les grands rapports de forces économiques que nous évoquions plus haut. Il ne faut qu’un engagement et une volonté politique: celle de faire prévaloir l’intérêt public !
Signataires
Aide Info Sida, Carrefour hépatites – aide et contact (CHAC), Alias, Centre Bruxellois de Promotion de la Santé (CBPS), Centre Médical Enaden, DUNE, Ex-Æquo, Espace P, Fédération Bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes (FEDITO BXL), Fédération Wallonne des Institutions pour Toxicomanes (FEDITO Wallonne), Fédération des Centres de Planning et de Consultations (FCPC), Fédération des Centres de Planning Familial des FPS (FCPF-FPS), Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial (FCPPF), Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF), Fédération des Maisons Médicales, Infor-Drogues, Lama (Centre médico-social pour toxicomanes), Maison d’Accueil Socio-Sanitaire de Bruxelles (MASS), Médecins du Monde Belgique, Modus Vivendi, Msoc Vlaams-Brabant, Observatoire du sida et des sexualités, Plate-Forme Prévention Sida, Prospective Jeunesse, Réseau ALTO (Réseau de médecins généralistes), Réseau d’Aide aux Toxicomanes (RAT), Réseau Hépatite C Bruxelles, Transit, Dr Chantal de Galocsy (hépatologue), Dr Christophe Moreno (hépatologue), Dr Jean-Pierre Mulkay (hépatologue), Dr Michel Roland (président de Médecins du Monde Belgique)…