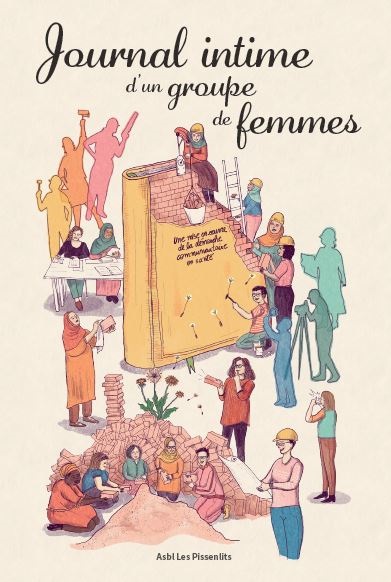Personnes âgées : obliger la solitude à faire profil bas
Le 26 Sep 23
Publié dans la catégorie :
Dans l’Eurégio Meuse-Rhin, le projet européen PROFILE, a catalysé une multitude d’initiatives inspirantes pour prévenir et lutter contre un sujet souvent tabou : la solitude des personnes âgées. Les outils sont à disposition des professionnels.
« Vous vous sentez seul.e ? Rejoignez-nous ». C’est sous ce slogan que des professionnels, des universitaires, des bénévoles, des milliers de personnes de tous les âges se sont mobilisées autour de la question de la solitude des aînés en situation de vulnérabilité. En home, au théâtre, à l’école et dans la rue, le projet baptisé euPrevent PROFILE, pour « Prévention de la solitude des personnes âgées dans l’Eurégio Meuse-Rhin » a donné la cadence dans ces territoires frontaliers belges, allemand et néerlandais pendant deux ans.
Leur mission : inventer des solutions pour répondre à cette préoccupation, particulièrement prégnante suite à la pandémie de Covid19, autour de la santé mentale des personnes âgées qui disent éprouver un sentiment de solitude. Dans les provinces belges, une majorité des plus de 60 ans sont touchés : 53% éprouvent un sentiment de solitude modéré (dont 12% une solitude sévère) contre 41% chez les voisins (avec une proportion de 6,9% côté néerlandais et 5,6% côté allemand pour les plus touchés) selon les données statistiques de l’atlas eurégional.

Territoire, collectif et inspiration
Face à ce constat, la dynamique territoriale et partenariale s’est appuyée sur trois piliers : la sensibilisation des professionnels et des citoyens, la promotion des échanges intergénérationnels et l’élaboration de lignes directrices et de bonnes pratiques.
Au terme de deux ans et demi d’échanges foisonnants, ce projet protéiforme dont la MC était partenaire, a permis de créer de nombreux outils à destination des professionnels. En premier lieu un guide d’inspiration publié en août dernier intitulé « Prévenir et combattre la solitude des personnes âgées ? » qui retrace cette mobilisation de longue haleine pour lutter contre la solitude des seniors. Qu’elle soit réelle ou subjective, choisie ou imposée, la solitude subie engendre une réelle souffrance psychologique, pouvant mener à la dépression voire un risque accru de mortalité.
« Il n’existe pas de solution toute faite pour lutter contre la solitude, et nous sommes conscients qu’avec notre approche, nous n’avons qu’une petite partie de la solution à cet immense problème », explique la chercheuse Marja Veenstra de l’Université de Maastricht, coordinatrice du projet euPrevent PROFILE en préambule de ce guide, qui compile une somme d’activités scientifiques et sociales, de contributions théoriques et pratiques. « Tout cela dans l’espoir de vous inspirer pour lutter contre la solitude des personnes âgées. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et d’inspiration » ajoute-t-elle.
Plusieurs rencontres ont émaillé cette mobilisation : parmi lesquelles cinq sommets citoyens intergénérationnels dans chacun des territoires pour que les jeunes de moins de 25 ans puissent échanger avec des personnes de 50 ans et plus hors de leur cercle familial. Ils ont discuté du concept de la solitude au sein des différentes générations en laissant les participants interagir les uns avec les autres.
Starlight et tartes aux pommes
Autre catalyseur de réflexion et de débats, la reprise, l’adaptation et la diffusion de la pièce de théâtre « Starlight et tarte aux pommes », créée par le metteur en scène flamand Luc Stevens. L’histoire se passe dans une maison de repos : une infirmière, un résident, un visiteur régulier et un bénévole. « Chacun a son caractère, son histoire et ses problèmes, décrit l’auteur. Nous voyons également des personnes du voisinage qui se sentent seules. Chacun à sa manière derrière les quatre murs ! Une tournure imprévue des événements met le foyer de soins à l’envers, mais le rêve de l’un des protagonistes crée une force de connexion qui pousse les gens à ne pas abandonner, à se rencontrer et à se renforcer les uns les autres ».
Ce spectacle originellement écrit en néerlandais a été traduit en français et en allemand, puis monté par des troupes locales. « Nous avons trouvé dans chaque région des troupes de théâtre, amateurs ou professionnels, pour l’interpréter, se la réapproprier tout en faisant passer le même message. Notre souhait est qu’elle puisse encore vivre et se jouer dans les différentes régions. Elle est d’ailleurs disponible à ceux qui le demandent, et a été imaginée pour être facilement transposable et jouée tant dans des théâtres que dans des homes ou des écoles… », explique Laura Nothelier, chargée de projets à la MC qui a participé au projet. En cette fin d’été, la pièce continue sa tournée en province de Limbourg.
Parmi les autres éléments mis à disposition du public figurent un atlas, des outils de mesure, des outils pédagogiques mais aussi des questionnements réflexifs sur la pratique (tant des professionnels que des volontaires). Enfin, deux revues de littérature permettent de cerner la problématique et son ampleur, et recenser les interventions qui ont porté leurs fruits. Un recueil de bonnes pratiques, disponible en ligne ; ainsi qu’une formation à destination des professionnels et des non-professionnels (volontaires, etc.). Cette formation, disponible sous forme de manuel sur le site du projet, entend répondre aux besoins identifiés par les acteurs de terrain sollicités. Les auteurs y abordent d’abord la notion de solitude, sa définition et ses corrélas (le sommeil, la santé mentale, la santé artérielle, etc.), ainsi que « la question de l’âgisme, des représentations stéréotypées qu’on peut avoir sur les personnes âgées (ou sur une autre génération que la sienne) ! », complète Laura Nothelier.
Enfin, un recensement des applications e-health est disponible via le site du projet.
Le projet s’est officiellement clôturé en août dernier autour d’une matinée d’échange sur la problématique, suivie d’un marché des associations, qui a réuni 180 participants issus des trois pays.
La suite ? « Que chacune des actions continue son petit bonhomme de chemin, soit réappropriée, fasse des émules… » conclut Laura Nothelier. A bon entendeur…
Une dynamique partenariale transfrontalière solidement ancrée
L’Eurégio Meuse-Rhin est une région de coopérations transfrontalières – l’une des plus anciennes d’Europe – qui recouvre des territoires belges (la province de Liège, la communauté germanophone et la province du Limbourg), néerlandais (la province du Limbourg), et allemand (Aix-la-Chapelle). Créée pour favoriser la coopération administrative, économique, dans les systèmes de santé, les acteurs de cette eurorégion peuvent bénéficier de fonds européens Interreg pour favoriser leurs projets de coopérations, au bénéfice de leurs habitants.
Le groupe de partenaires transfrontaliers du projet s’est constituée autour d’un premier projet Interreg (EuPrevent Senior friendly Communities), sous le label « Communes Amies des Seniors », dont le public final étaient les personnes âgées atteintes de démence. La collaboration entre les partenaires ayant été porteuse, ils ont souhaité continuer et s’attaquer cette fois à la problématique de la solitude des aînés dans leur région. C’est ainsi qu’en avril 2021, le projet euPrevent PROFILE (pour « Prévention de la solitude des personnes âgées dans l’Eurégio ») a pu démarrer, pour s’achever en août 2023.
Parmi les partenaires, on retrouve des profils institutionnels différents : les universités de Maastricht (pilote du projet) et de Liège, la Mutualité chrétienne (MC), Bagso (Fédération des organisations des personnes âgées en Allemagne), LOGO (les consultations locales de santé en Flandre), GGD Zuid Limburg (regroupement local des services de santé en Flandre), ainsi que l’Aviq pour la Wallonie et son pendant régional allemand. « Chaque partenaire avait un atout intéressant. Certains, comme Bagso, bénéficient d’un réseau étendu d’acteurs de terrain ; les universités quant à elles ont des pôles de recherche liés à la thématique. Se sont ainsi mêlées des institutions qui travaillaient spécifiquement sur la question du vieillissement et d’autres avec une casquette plus large de promotion de la santé », explique Laura Nothelier, chargée de projets à la MC.
A ceux-ci s’ajoutent toute une série de partenaires associés, ayant déjà collaboré lors du précédent projet ou rencontrés lors du lancement du projet, tous sondés sur la problématique, afin d’en comprendre tous les contours et s’assurer de répondre aux besoins du public final. Puis d’autres encore sont venus agrandir les rangs, rencontrés au fur et à mesure lors des actions déployées.
Solitude ou isolement ?
La solitude est un sentiment subjectif qui peut résulter d’un manque subjectif de contacts et de relations sociales, causé, par exemple, par l’isolement social. Avec une nuance toutefois : l’isolement social et la solitude ne recouvrent pas la même notion, mais peuvent être corrélés. Une personne isolée socialement peut souffrir ou ne pas souffrir de solitude par exemple. Il faut aussi différencier la solitude d’une personne solitaire, qui apprécie sa propre solitude.
Et il y a d’autre part la solitude ressentie par une personne qui a un réseau social étendu mais qui ressent le manque de ne pas avoir une personne à ses côtés avec laquelle vivre et échanger.
La solitude n’est pas l’apanage des personnes âgées (une idée trop souvent répandue…), mais c’est toutefois un public à risque. Or, un habitant sur cinq dans l’Eurégio Meuse-Rhin a 65 ans ou plus. Et cette proportion va croître dans les prochaines années.
Les facteurs de risque de la solitude
Facteurs démographiques
Age : la solitude suit une distribution en forme de U : elle est la plus répandue entre 18 et 25 ans et atteint un pic à 65 ans chez les adultes plus âgés.
Genre : la solitude est plus répandue chez les femmes que chez les hommes.
Statut marital : les personnes non mariées se disent généralement plus seuls que les personnes mariées.
Situation de vie : le fait de vivre seul est associé à des niveaux plus élevés de solitude. Toutefois, les personnes vivant dans des environnements de vie assistés (par exemple, des maisons de retraite) se sentent plus seules que les personnes âgées vivant en communauté.
Statut socio-économique : un revenu plus faible, un niveau d’éducation plus bas, la fréquence des problèmes économiques et le fait de vivre dans des quartiers pauvres sont associés à des niveaux plus élevés de solitude.
Statut migratoire : les migrants ont déclaré se sentir plus seuls que les non-migrants.
Facteurs liés à la santé
Santé physique : les indicateurs de santé physique tels qu’une mortalité et une morbidité plus élevées, un mauvais sommeil et une réactivité cardiovasculaire accrue (taux de cholestérol et pression artérielle plus élevés) sont corrélés à des niveaux de solitude plus élevés.
Santé mentale : une plus grande solitude est associée à des symptômes de santé mentale plus graves, notamment l’anxiété sociale, la dépression et la paranoïa, ainsi qu’à une moins bonne régulation émotionnelle.
Santé cognitive : des niveaux plus élevés de solitude sont associés à un déclin cognitif accéléré et à un risque accru de maladie d’Alzheimer et de démence chez les personnes âgées.
Cerveau, biologie et génétique : la solitude active les régions neuronales impliquées dans la détection des menaces, l’attention et le traitement des émotions. De plus, des niveaux plus élevés de solitude sont associés à des modifications structurelles de la matière grise et blanche, à une altération de la connectivité fonctionnelle et structurelle du cerveau et à une augmentation du cortisol circulant.
Facteurs environnementaux et sociaux
Communication numérique : peut augmenter ou diminuer le sentiment de solitude, en fonction de la manière dont elle est utilisée et des raisons pour lesquelles elle l’est.
Lieu de travail : la solitude sur le lieu de travail est associée à de moins bons résultats sur le lieu de travail (c’est-à-dire une baisse de la productivité, de la satisfaction au travail et de la créativité).
Extrait tiré de la Newsletter « Lonely ? Let’s unite ! Avril 2022 », envoyée par les responsables du projet PROFILE et consultable ici : https://euprevent.eu/fr/lonely-lets-unite-news-avril-2022/#section1
et d’après les données tirées de l’étude : Lim, M.H., Eres, R., Vasan, S., 2020. Understanding loneliness in the twenty-first century: an update on correlates, risk factors, and potential solutions. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. 55, 793–810. https://doi.org/10.1007/s00127-020-01889-7