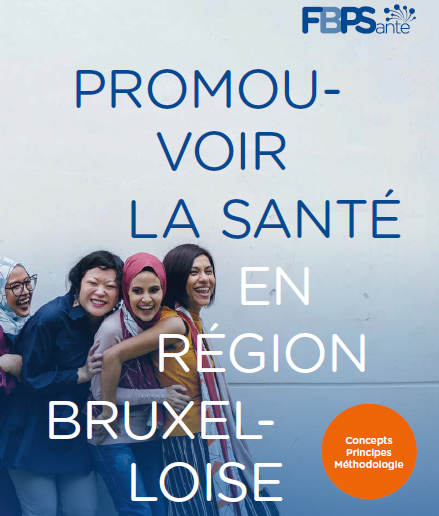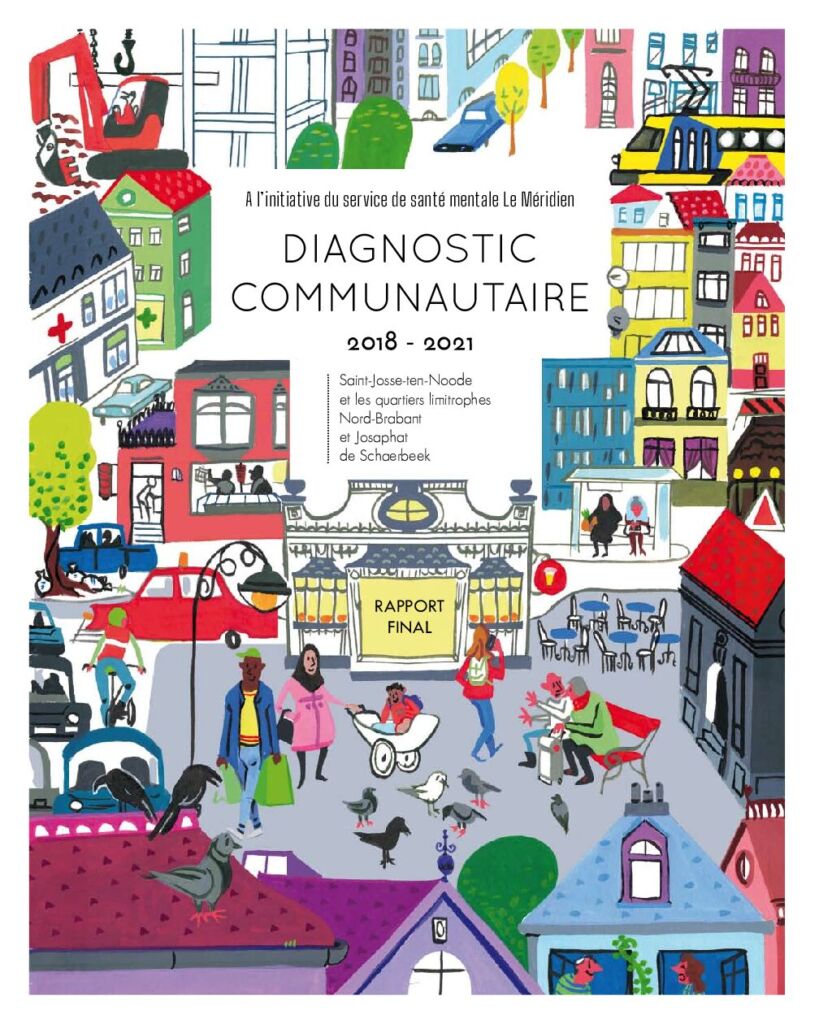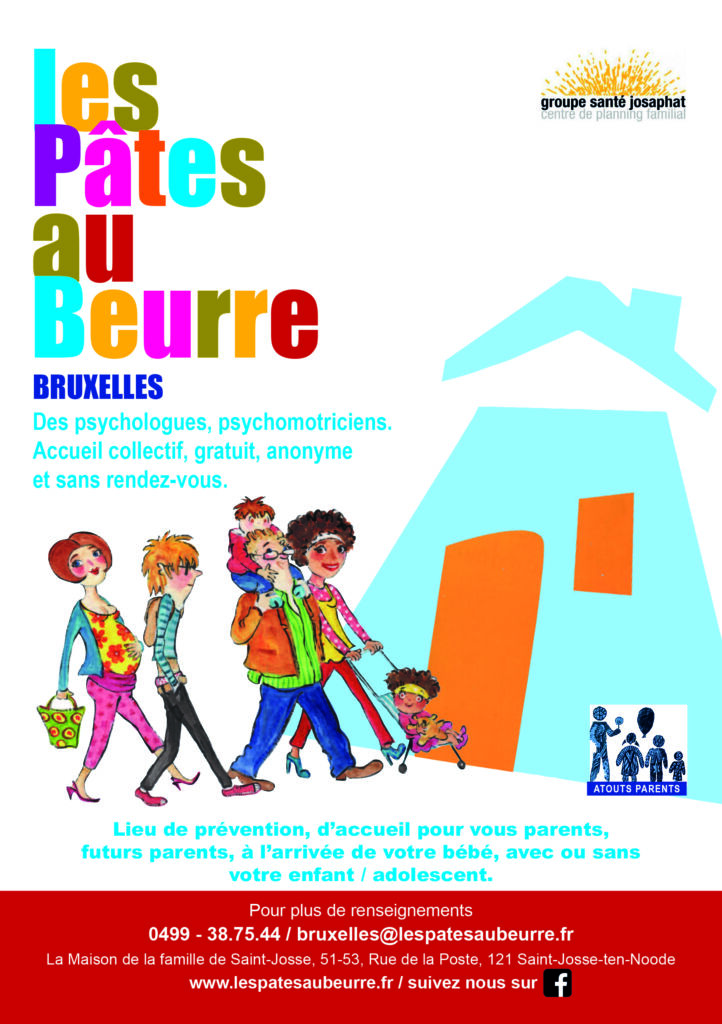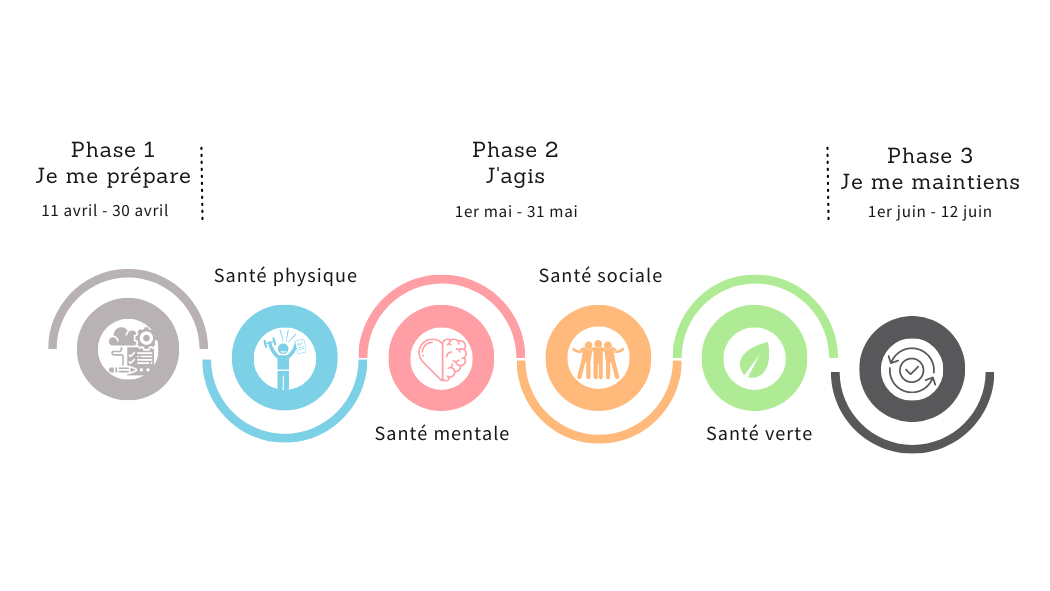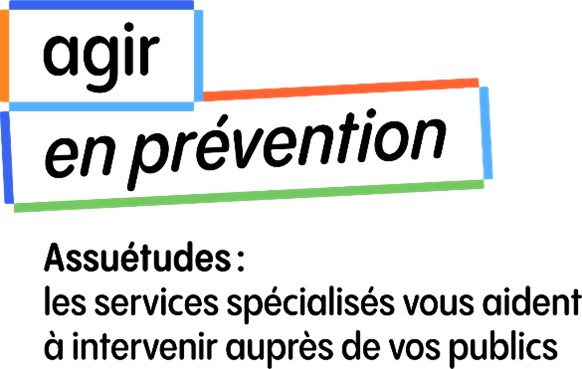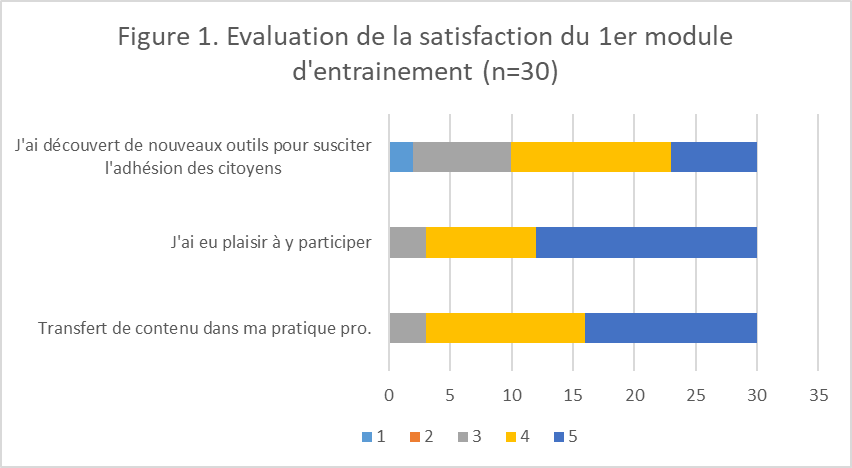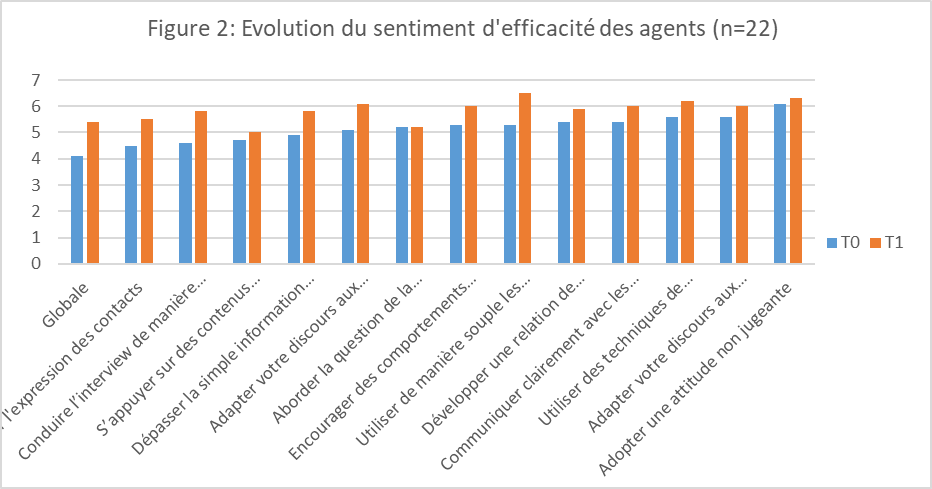Renforcer l’accessibilité aux données de santé numériques
Le 3 Nov 22
Publié dans la catégorie :
L’exclusion numérique n’est pas une préoccupation nouvelle. Cependant, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la digitalisation de notre société et de ses services essentiels s’est accélérée. Au travers de son Baromètre de l’Inclusion numérique, la Fondation Roi Baudouin a souhaité objectiver ce phénomène et attire notre attention sur les personnes en situation de vulnérabilité numérique, problématique qui concerne près d’un Belge sur deux (46% de la population âgée entre 16 et 74 ans), et – sans surprise – ce sont les personnes défavorisées sur le plan socio-économique et culturel qui sont le plus touchées par ces difficultés.

Quelques constats en 2021
De manière générale, la connectivité des Belges augmente (l’accès à internet et aux outils numériques tels que les ordinateurs portables). Notons toutefois que davantage de ménages à faible revenu ne disposent pas d’une connexion à domicile (18% d’entre eux) en comparaison aux ménages à haut revenu (dont 98% bénéficient d’une connexion à domicile).
Ensuite, l’utilisation des services essentiels a augmenté auprès de l’ensemble de la population entre 2019 et 2021, comme l’e-santé (qui a augmenté de 11%) par exemple. Le niveau d’éducation reste cependant un facteur déterminant car il existe une différence d’environ 30% suivant que l’on ait un faible ou un haut niveau de diplôme.
En termes de compétences numériques, 46% de la population belge âgée entre 16 et 74 ans est en situation de vulnérabilité numérique. Parmi eux :
- 7% de la population n’utilise pas internet ;
- 39% de la population ont des faibles compétences numériques en 2021 (contre 32% en 2019). Cette augmentation de la vulnérabilité est observée dans tous les groupes, mais elle est plus marquée auprès des personnes ayant un faible niveau d’éducation (18% d’entre elles, contre 9% des personnes ayant un haut niveau de diplôme).
La Fondation Roi Baudouin souligne enfin que les principaux publics à risque de décrochage numérique sont les personnes avec un faible niveau de revenu ou de diplôme, les personnes à la recherche d’un emploi et les personnes de plus de 55 ans. Attention toutefois à ne pas considérer les jeunes (entre 16 et 24 ans) comme égaux face aux compétences numériques : 45% des jeunes peu diplômés ont des faibles compétences numériques (contre 22% des jeunes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur).
Le niveau de formation devient de plus en plus déterminant quant à l’utilisation des services essentiels et les compétences numériques. (…) Réduire la fracture numérique implique de continuer à investir dans la digitalisation pour toutes et tous et de conserver, à côté des canaux numériques, le bon vieux téléphone et les contacts physiques. L’inclusion doit être au cœur de la conception des outils numériques, afin que les personnes peu à l’aise avec le numérique puissent facilement les utiliser.
Baromètre de l’Inclusion numérique, Fondation Roi Baudouin
Le projet de la Maison médicale Espace Santé
Au sein de cette maison médicale, située à Ottignies, les constats sur la digitalisation des données de santé, accélérée durant la pandémie et creusant davantage le fossé des inégalités, sont les mêmes. Pour y répondre, l’équipe a mis en place des ateliers numériques pour leurs patients, en partenariat avec l’Espace public numérique d’Ottignies. Ce projet est soutenu dans le cadre des Stratégies concertées Covid en Wallonie. Ludivine Teller (FWPSanté) a rencontré Christine Sbolgi, coordinatrice du projet et Martine Verhelst, médecin à la maison médicale :
Ludivine Teller : Pendant la pandémie, certains de vos patients éprouvaient des difficultés face au numérique. C’est ce qui a inspiré votre projet ?
Christine Sbolgi : « Lors de la pandémie du coronavirus, le public avait besoin d’accéder à des documents digitaux pour pouvoir continuer à vivre ou répondre aux difficultés liées à la Covid. Notre projet part d’un constat : cette situation était très angoissante et compliquée pour certains. Nous rencontrions des patients angoissés, épuisés, avec une incompréhension totale de ce qu’ils devaient faire. Comment alors prendre en main sa propre santé face à toutes ces exigences numériques ?
Des membres de notre comité de patients nous ont également interpelés au sujet de cette fracture numérique, et nous avons réfléchi à une manière d’améliorer l’accessibilité aux données de santé numériques. »
Dr. Martine Verhelst : « De là est née l’idée d’apporter cette compétence aux gens pour qu’ils puissent le faire eux-mêmes. Pour réduire la surcharge administrative à la maison médicale, mais aussi pour permettre au patient d’être autonome dans ses démarches. Cela renforce son estime de lui-même. »
Ludivine Teller : Vos ateliers numériques dépassent le cadre de la Covid…
Christine Sbolgi : « La pandémie nous a donné l’impulsion des ateliers, parce qu’il y avait un besoin d’accéder à des documents assez rapidement. Mais maintenant, on se rend compte qu’il y a toute une digitalisation de la santé qui s’est mise en place. Il y a un boum numérique partout.
C’est arrivé comme ça, sans qu’on ne soit vraiment au courant. Tout le monde, aujourd’hui, a une page sur masanté.be avec des données de santé. Tout le monde est censé donner un consentement éclairé pour permettre l’accès à ces données.
Notre objectif n’est pas de convaincre du bien-fondé de cette digitalisation. On essaie surtout d’aider le patient à s’en rendre compte et à se faire une opinion, à comprendre ce que sont la santé digitale et le consentement éclairé. Et de le préparer, dans l’éventualité d’une nouvelle crise, à pouvoir utiliser tous ces outils. Parce qu’en cas de pandémie, ces outils ont été utiles. »
Ludivine Teller : Quel lien entre digitalisation et augmentation des inégalités en santé ?
Christine Sbolgi : « La solitude, l’isolement, c’est justement ce qui fait grandir les inégalités sociales en santé. Alors si l’on ne peut pas accéder au numérique, par exemple au CST pendant la pandémie, on ne fait que s’isoler encore plus. En facilitant cet accès, on œuvre pour la diminution des inégalités sociales en santé.
Et puis la digitalisation de la santé, ce sont aussi des données personnelles sensibles dont on ne se rend pas compte. Sur masante.be, il y a des données de santé qui pourraient être mal utilisées. Dans les violences intrafamiliales ou conjugales, il y a beaucoup de jeu autour de ces données sensibles : pouvoir savoir que son conjoint a été voir tel médecin, ou que sa fille adolescente a été voir un gynécologue… C’est délicat.
Mais cette numérisation a aussi des avantages : les gens ont la possibilité d’avoir un meilleur accès à leur santé. Le fait de pouvoir gérer sa santé, retrouver ses résultats, comprendre les documents, avoir une autonomie sur son dossier, comprendre ce qu’est le consentement éclairé ou le don d’organes… peut accroître l’autonomie et la confiance en soi, sortir de l’isolement, aider à être proactif. C’est l’empowerment, donc être dans le pouvoir d’agir sur sa santé. »
Ludivine Teller : Il y a donc encore du travail pour améliorer l’accès aux données de santé digitales et la compréhension de tous leurs enjeux…
Christine Sbolgi : « Bien sûr, on ne peut pas arrêter le progrès, mais il faut se rendre compte que les inégalités ne font que grandir avec cette digitalisation. Et que l’accès à la santé doit être pour tous de manière égale. Si tout est digitalisé, plein de gens ne peuvent pas s’impliquer. »
Dr Martine Verhelst : « Cette digitalisation est une machine à renforcer les inégalités. Et ce constat-là est horrible. C’est pour ça que l’on fait les ateliers, et que l’on s’investit aussi dans la réflexion des Stratégies concertées. Car il faut mieux tenir compte des publics marginalisés dans cette digitalisation qui est utile. Il y a énormément d’avantages, mais aucun système n’est parfait. Donc c’est perfectible, pour veiller à ne pas renforcer l’exclusion des publics non numérisés. »
L’interview du projet de la Maison médicale Espace Santé à Ottignies a fait l’objet d’un article « Projet à la Une – L’éducation à la santé digitale », publié sur le site de la Fédération Wallonne de Promotion de la Santé en juin 2022 : https://www.fwpsante.be/projet-a-la-une-leducation-a-la-sante-digitale/. Elle est reproduite avec l’aimable autorisation de l’autrice.
Le projet de la Maison médicale Espace Santé bénéficie du soutien de la Wallonie grâce au dispositif des Stratégies concertées Covid. Petit rappel sur ce dispositif d’ampleur en Wallonie, coordonné par la Fédération Wallonne de Promotion de la Santé (FWPSanté).
Les Stratégies concertées Covid en Wallonie : kesako ? Et où en est-on ?
Le dispositif des Stratégies concertées Covid, soutenu par le Gouvernement wallon, rassemble différents acteurs et actrices qui œuvrent en promotion de la santé. Cette approche intersectorielle vise à identifier des réponses à la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences sur la santé et ses déterminants, tout en tirant des enseignements pour le futur.
Dans ce contexte, plus de 250 professionnels de la santé et du social wallons ont été interrogés au cours d’ateliers participatifs et d’entretiens. Ce travail a permis d’identifier les actions pertinentes et concrètes mises en place durant la crise sanitaire, ainsi que celles qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre pour améliorer la gestion du risque et réduire les impacts négatifs de la crise COVID-19 sur les publics vulnérables. La suite de ce travail de concertation a permis de valider les actions considérées comme prioritaires. À l’issue de l’analyse des données récoltées, les constats et propositions d’actions ont été intégrés dans le cadre du Plan wallon de Prévention et de Promotion de la Santé (WAPPS) et de la programmation 2023-2027.
Au terme d’une année de concertation et d’analyse, le rapport complet vient d’être transmis aux autorités. Un travail de résumé des pistes d’actions opérationnelles est à présent en cours et sera communiqué prochainement. Celui-ci servira notamment un objectif de plaidoyer en promotion de la santé. Nous vous en parlerons plus en détail dans notre numéro de janvier.
Tout savoir sur les Stratégies concertées Covid : www.fwpsante.be/strategies-concertees-covid-19