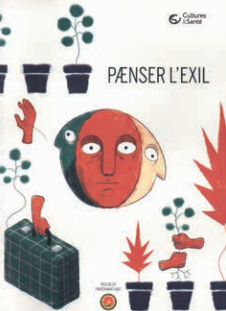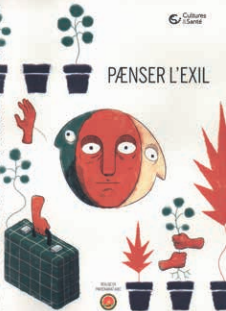Pour une cantine saine, savoureuse et durable
Le 30 Déc 20
Publié dans la catégorie :
En 2012, la Fédération Wallonie-Bruxelles lançait une initiative intéressante relative à la qualité des repas servis aux enfants en collectivités. Deux ans plus tard, nous avons voulu connaître le destin de cette démarche commune aux trois ministres de la Santé, de l’Enseignement obligatoire ainsi que de l’Enfance. Nous avons rencontré Tatiana Pereira, en charge de ce projet à la DG Santé de la Communauté française.Éducation Santé: Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste ‘La santé au menu des cantines’?Tatiana Pereira: Dans le cadre du Plan national nutrition santé belge, le Service public fédéral Santé publique a développé début 2012 trois cahiers spéciaux des charges (CSC) relatifs à :
- la fourniture de repas chauds sur base de critères stricts en matière d’équilibre alimentaire, de saveurs et de développement durable dans les collectivités d’enfants;
- la gestion de fontaines et de distributeurs de boissons et d’en-cas dans une perspective d’alimentation saine, durable et d’insertion socioprofessionnelle;
- l’exploitation de restaurants d’entreprise s’inscrivant dans une démarche d’alimentation durable.
La Fédération Wallonie-Bruxelles s’est appropriée le modèle de CSC pour les collectivités d’enfants. Il a été retravaillé par les Hautes Écoles de diététique afin d’en affiner certains aspects.
Ce nouveau modèle de CSC est orienté vers la fourniture des repas durant le temps de midi uniquement, il n’est pas, à ce stade, adapté à l’organisation de repas pour une journée entière. Il a été proposé à l’ensemble des écoles et des centres de vacances de Bruxelles et de Wallonie.
Afin de soutenir la diffusion et l’appropriation du CSC, un dispositif de formations et d’accompagnements par les Hautes Écoles a été mis en place pendant l’année scolaire 2012-2013. Il a débuté par une journée de sensibilisation où toutes les directions et pouvoirs organisateurs ont été invités (établissements scolaires, centres de vacances et acteurs de santé-CPMS et SPSE).
Résultats quantitatifs
ES: Quel dispositif avez-vous mis en place?TP: Les 4 Hautes Écoles de diététique de la FWB ont proposé une vingtaine de modules de formation (de 3 demi-journées) destinés au personnel de cuisine.
Un guide alimentaire complémentaire au CSC a été conçu par les Hautes Écoles, il a été remis aux écoles participantes et est disponible sur le site www.sante.cfwb.be, mot-clé Cantines/Alimentation.
Une circulaire présentant l’initiative et invitant les personnes à une journée d’information a été envoyée à tous les pouvoirs organisateurs et directions d’établissements scolaires et de centres de vacances, ainsi qu’aux services de promotion de la santé à l’école et aux centres psycho-médico-sociaux. Cette séance d’information a rassemblé 77 personnes, plus une trentaine de personnes des administrations, de la presse et des cabinets ministériels.
En mars 2013, trois séances d’information/sensibilisation ont été organisées de manière décentralisée avec la collaboration des Centres locaux de promotion de la santé. Un des objectifs poursuivis était de faire le lien entre le CSC et les projets de promotion de la santé qu’il est possible de mettre en place autour des questions d’alimentation au sein des écoles. Ces journées ont eu lieu à Charleroi, Liège et Libramont. 118 personnes s’y sont inscrites. Suite à ces séances, de nouvelles demandes de formation et d’accompagnement ont émergé.ES: Quel bilan tirez-vous aujourd’hui de cette opération?TP: Tout d’abord, je peux vous indiquer quelques données chiffrées (à la fin de l’année scolaire 2012-2013). La page internet la plus consultée est la plus générale, suivie par le cahier des charges. Ce dernier n’a pas été diffusé en version papier avec la circulaire, les personnes était invitées à venir le télécharger. Le formulaire de téléchargement a été consulté 360 fois, je ne connais pas le nombre exact de téléchargements effectifs.
Par ailleurs, une version papier a été distribuée aux personnes venues aux différentes journées d’information, soit 400 exemplaires en tout.
Des versions papiers du CSC ont également été envoyées aux 262 communes de Bruxelles et de Wallonie.ES: Et les formations?TP: 98 personnes de 60 institutions se sont inscrites aux formations qui ont eu lieu entre octobre 2012 et avril 2013. Quatre modules de formation sur les 16 programmés ont dû être annulés faute de participants.
Suite aux trois demi-journées d’information décentralisées, plusieurs nouvelles demandes ont été enregistrées et le dispositif de formation/accompagnement a été prolongé jusqu’à la fin du mois d’octobre. Cela a permis d’organiser 3 modules de formation supplémentaires pour 42 personnes et l’accompagnement de 9 écoles à la rentrée.Au total 140 personnes de 63 institutions ont été formées.Les personnes qui ont suivi la formation sont essentiellement des cuisiniers et des comptables/économes. Les établissements scolaires sont les institutions les plus demandeuses (38), mais on trouve aussi 9 centres sportifs, 6 internats, 4 centres de vacances, 1 crèche, 2 pouvoirs organisateurs provinciaux, 1 fournisseur et 2 asbl actives en matière de prévention. Au niveau géographique, il y a 7 institutions bruxelloises et 56 en Wallonie. En outre, 20 institutions ont demandé un accompagnement, 4 dans la capitale et 16 en Wallonie.
Enseignements qualitatifs
ES: Avez-vous pu recueillir des éléments d’appréciation qualitatifs?TP: En effet, un questionnaire d’évaluation a été proposé via le site internet à toutes les personnes qui ont laissé leurs coordonnées (participation à une des journées d’information, téléchargements du CSC, demandes de formations et d’accompagnements). Au total 209 personnes/institutions ont été sollicitées et 40 ont répondu.
Parmi ceux qui proposent des repas sur le temps de midi, 22 institutions les préparent dans leur cuisine interne et 6 font appel à un fournisseur extérieur.
Les repas sont chauds et froids dans 22 institutions, exclusivement chauds dans 10 autres.
21 personnes cherchaient à s’informer en prenant connaissance du CSC, 17 souhaitaient modifier l’offre de repas préparés en interne et 4 envisageaient de s’en servir pour lancer un appel d’offres.
Globalement, les personnes ont trouvé le CSC complet, compréhensible, utile et adapté aux besoins. Quelques personnes ont cependant répondu à l’inverse que le CSC n’était pas adapté: parce que l’établissement appliquait déjà des critères plus précis, ou au contraire que le CSC était trop lourd et trop complexe pour des petits fournisseurs et pour les petites structures, ou encore parce que les changements d’habitude alimentaire sont difficiles et doivent commencer à la maison.ES: Quel a été l’impact concret sur les repas offerts aux enfants?TP: Au niveau des modifications, 31 personnes ont répondu aux questions (voir tableau).
|
Sujet |
Pas d’intention de modification |
Intention de modification |
Modification réalisée depuis la prise de connaissance du CSC |
|
Portions/grammages |
8 |
15 |
6 |
|
Achat auprès de fournisseurs locaux et/ou durables |
14 |
8 |
9 |
|
Choix de produits de saison ou bio |
7 |
16 |
8 |
|
Introduction de menus végétariens |
19 |
6 |
6 |
Voici un commentaire intéressant fait par un des fournisseurs:«Ces éléments étaient déjà dans notre positionnement d’offre alimentaire pour les écoles. Le CSC a permis d’appuyer encore notre démarche afin de cautionner principalement l’approche autour du grammage des viandes qui est le point le plus difficile à mettre en œuvre, vu les freins dus aux habitudes alimentaires.»Parmi les 40 répondants, 7 institutions ont sollicité un accompagnement par une Haute École, mais il n’y a pas assez d’éléments d’évaluation.
11 établissements ont envoyé du personnel en formation: pour 8 d’entre eux, cette formation répondait aux attentes, pour 3 elle n’y répondait que partiellement.En dehors de l’impact sur l’offre de repas chauds, 16 répondants annoncent que le CSC a également eu un impact sur:
- l’intégration des questions d’alimentation dans le projet d’établissement ou dans le projet d’accueil;
- l’intégration des questions d’alimentation dans une approche plus large (bien-être, activité physique, environnement et développement durable);
- la mise en place d’animations/activités ‘alimentation’ pour les enfants;
- la sensibilisation/information vers les parents;
- la formation du personnel d’encadrement des temps de midi, la négociation avec les traiteurs, la responsabilisation du personnel, le tri des déchets, la justification de l’offre auprès des parents.
Les répondants ont aussi fait certaines autres propositions intéressantes:
- prévoir des formations pour le personnel qui encadre les enfants sur le temps de midi;
- maintenir l’initiative et prévoir des outils à long terme pour améliorer les services repas;
- témoigner auprès de l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) de ce que la santé ne dépend pas uniquement de l’hygiène des aliments, ni des conditions de préparation des repas;
- penser un CSC pour la fourniture des matières premières;
- continuer à fédérer les autorités santé, environnement, enseignement et culture;
- développer des incitants pour les écoles qui mettent en place le CSC;
- prévoir une certification pour les écoles qui participent activement au projet;
- dégager du temps pour s’impliquer dans ce genre d’initiative très intéressante;
- concevoir cette initiative au sein d’un projet d’école impliquant parents, élèves, professeurs, direction, cuisine… Le changement doit être progressif, en passant par la maison, puis par des séances en classe avant d’initier un changement en cuisine.
ES: Cela fait pas mal de bonnes idées cela. Avez-vous pu tirer d’autres constats?TP: Tout à fait. Je pourrais les résumer en 3 points, concernant les formations, les accompagnements et l’organisation des repas.
À propos des formations
Plusieurs personnes ayant participé aux formations ne connaissaient pas le CSC et le principe de ces formations. Elles ont été envoyées en formation par leurs directions qui ne les ont pas informées préalablement de ce qu’elles allaient faire. Cependant, les participants ont très majoritairement montré un intérêt marqué pour les contenus de formation. Ils pensent pour la plupart mettre en œuvre l’un ou l’autre changement.
Certains auraient souhaité que la formation se passe en cuisine pour des exercices pratiques.
Il manque une implication et formation des équipes éducatives (y compris le personnel encadrant les enfants au moment des repas). Les cuisiniers se sentent parfois un peu seuls pour travailler sur des changements. Beaucoup de réticences ainsi qu’un manque de connaissance, de sensibilisation de la part du corps enseignant sont relatées par les participants.
Des demandes ont été formulées pour que des modules soient prévus au Luxembourg, les lieux habituels de formation étant difficiles d’accès pour les Luxembourgeois. Deux modules décentralisés ont dès lors été organisés pour un total de 24 personnes.
Il a également été suggéré que l’on puisse dispenser des formations sur le lieu de travail pour que tous les cuisiniers puissent y assister.
Enfin, certains participants sont demandeurs d’un suivi et de formations continues sur ces sujets.
À propos des accompagnements
Il s’est rapidement avéré que les institutions avaient besoin d’être accompagnées pour mettre en œuvre des changements dans leur cuisine et pas seulement pour le lancement d’un appel d’offres. Les accompagnements ont donc été adaptés.
Comme pour les formations, certaines institutions demandeuses ne savaient pas vraiment en quoi consistait l’accompagnement (parfois demandé par la direction mais fourni à l’économe ou au chef de cuisine).
De manière générale par rapport au CSC et à l’organisation des repas
Les institutions sont demandeuses de listes de producteurs/fournisseurs pour les denrées alimentaires qui correspondraient au CSC (circuit court, bio). Des liens ont été faits vers Bioforum, mais actuellement cela reste une question problématique pour les établissements (surtout ceux qui font la cuisine en interne).
Le coût des repas semble fort élevé par rapport à ce qui est offert classiquement.
Les établissements qui organisent des repas toute la journée (internats, centres d’hébergement) sont aussi demandeurs d’accompagnement, malgré le fait que le CSC ne concerne que les repas de midi. Les établissements qui sont venus aux séances décentralisées sont demandeurs de projets globaux.ES: Alors, un bilan plutôt mitigé ou encourageant?TP: On peut conclure que l’initiative du lancement du CSC ‘Cantines saines, savoureuses et durables’ a rencontré des attentes et suscité de l’intérêt. Évidemment, le taux de participation par rapport à l’ensemble des écoles et centres de vacances peut sembler faible, mais il faut noter que les PO sont une ouverture vers de nombreux établissements.
Les accompagnements et les formations semblent être bien adaptés, toutefois, de nombreuses demandes vont vers un soutien à plus long terme et qui englobe aussi les autres acteurs scolaires (éducateurs et enseignants).
L’intérêt de certains fournisseurs (dont Sodexo, un des leaders du secteur de la restauration collective) pour l’initiative est un signe positif de prise en compte des critères du CSC.
Dans le même ordre d’idée, l’APAQW a développé une centrale d’achats qui permet de trouver des fournisseurs de produits locaux, ce qui répond à une demande des institutions. De même, Simply Food a réalisé un guide ‘Alimentation durable dans les collectivités’ à la demande de Bruxelles Environnement.ES: Des pistes pour le futur?TP: Afin de soutenir la diffusion et l’utilisation du CSC et contribuer à améliorer l’alimentation des enfants, les recommandations suivantes ont aussi été faites:
- terminer les modules de formation par des exercices pratiques;
- compléter l’information par un vade-mecum plus concis et plus concret que le guide alimentaire;
- proposer de nouveaux modules de formation pour l’année scolaire 2013-2014 et des accompagnements. Ces derniers seront mieux expliqués aux demandeurs;
- proposer l’outil de l’asbl CORDES ‘Se mettre à table’ pour mieux impliquer les équipes éducatives;
- renforcer les liens avec l’Observatoire de la Santé de la Province du Luxembourg en le mettant en contact avec les écoles de ce territoire;
- s’appuyer sur des ressources locales grâce aux CLPS pour un travail sur l’ensemble des déterminants et pouvoir impliquer les équipes éducatives;
- partir d’un projet émanant de la base (projet porté par l’ensemble des acteurs scolaires afin de travailler la transversalité). Il est en effet important de travailler aussi sur ce que les enfants mangent en dehors du repas de midi tout en augmentant la qualité des repas proposés à l’école. Des projets transversaux permettraient également de travailler sur l’alimentation même lorsque l’école n’a pas la possibilité de proposer des repas chauds.
- ultérieurement une adaptation du CSC pour les centres sportifs et pour les hébergements (centres de vacances, internats, aide à la jeunesse…) serait un axe de travail à développer.
ES: Cela fait pas mal de pain sur la planche pour les années qui viennent !
Voir l’article de C. De Bock ‘Que mange-t-on ce midi à la cantine scolaire?’, Éducation Santé 285, janvier 2013.